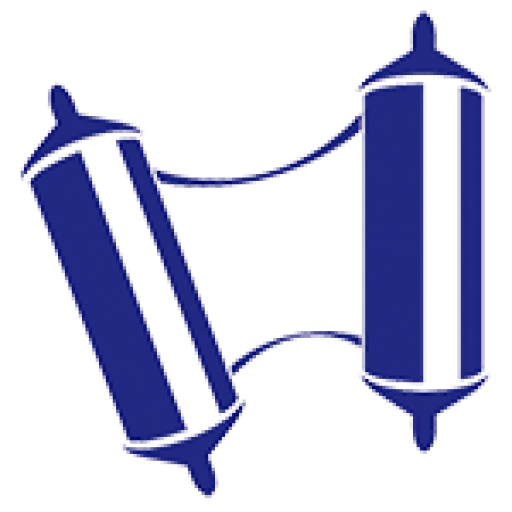Euthanasie et acharnement thérapeutique par le Grand Rabbin Michel Gugenheim
La question de l’euthanasie revient périodiquement sous les feux de l’actualité. Le développement des techniques médicales, parce qu’elles parviennent parfois à prolonger la vie mais pas la qualité de vie, accroît constamment le nombre de ces situations tragiques où la mort apparaît comme la seule solution satisfaisante, et comme le plus doux des remèdes.
Qu’il s’agisse de cas de malformations néonatales graves, de malades incurables en proie à des souffrances intolérables, ou de sujets plongés dans une vie purement végétative, le droit à l’euthanasie est revendiqué de plus en plus souvent, et ses partisans militent passionnément pour obtenir, au nom de la liberté, de la dignité, et du respect de la personne, la légalisation du « meurtre par amour ». C’est dans ce contexte que nous tenons à rappeler la position du judaïsme de la Tora en ce domaine.
« Il est interdit de faire quoi que ce soit pour hâter le mort (…) et même si nous voyons qu’il souffre beaucoup dans son agonie et que la mort lui serait douce, il nous est néanmoins défendu de faire quoi que ce soit pour hâter la mort ; le monde et ce qu’il contient appartiennent à D. et telle est Sa volonté. »
C’est l’avis unanime des décisionnaires qu’exprime ici l’auteur du Aroukh Hachoul’han (Yoré Déa 339, 1) condamnant ainsi clairement toute forme d’euthanasie active. L’idée sur laquelle il appuie cette défense -l’âme tout comme le corps, appartient à D.; c’est Lui qui l’a insufflée, à Lui seul revient le droit de la reprendre – est exprimée déjà par le prophète Ezéchiel (18, 4) : « Voici, toutes les vies sont à Moi, la vie du père comme la vie du fils, elles sont à Moi. »
Une prise de position si radicale est choquante à première vue en ce qu’elle semble se désintéresser totalement de la souffrance humaine. La miséricorde, la pitié, sont pourtant des vertus décrites dans le Talmud comme spécifiques d’Israël !
En réalité l’étude en profondeur du droit hébraïque montre à quel point celui-ci est sensible à la souffrance. Le concept même de « belle mort » est cité dans le Talmud (Baba Kama 51, a) : « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même -choisis-lui une belle mort. » C’est en vertu de ce principe que les condamnés à mort (1) buvaient une potion anesthésique avant de subir leur peine (cf. Maïmonide, Hilkhot Sanhédrin 13, 2).
La question de l’euthanasie consiste donc, en fait en un conflit d’intérêts qui touche tout spécialement des points de sensibilité juive : le souci explicite du judaïsme d’atténuer la souffrance humaine doit être pesé face à la sainteté de la vie elle-même ». (2)
Ainsi, la primauté accordée, en l’occurrence, à la vie sur la souffrance exprime de la manière la plus éloquente possible le caractère sacré, intangible, absolu, que le judaïsme attribue à la vie. Idée qu’exprimait déjà le Psalmiste (Ps. 118, 18) : « Le Seigneur m’a fait beaucoup souffrir mais il ne m’a pas livré à la mort. »
NUANCES
Même en sa durée la plus courte, même condamnée à brève échéance, la vie représente une valeur suprême, incontournable. Même pour une « vie d’un instant » on peut transgresser le Chabat (Yoma 85 a), ainsi que le consigne le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm 329, 4) : « Même si on lui trouve la cervelle écrasée et qu’il ne peut vivre qu’un moment, on dégage les décombres (en cas d’ensevelissement sous un éboulement). »
Précisons que la valeur de la vie momentanée est indépendante de la qualité de vie dont dispose la personne, ainsi que de ses capacités, voire de sa conscience. En effet, « nous ne disposons d’aucun étalon nous permettant de mesurer le prix et l’importance de la vie » (3) ; « la valeur de la vie humaine n’est pas quantifiable, et c’est pourquoi elle est indivisible, chaque particule en est infinie » (2).
On conçoit, dès lors, que la loi juive considère l’atteinte portée à une telle vie momentanée comme un véritable meurtre : « Celui qui ferme les yeux (d’un agonisant) au moment où l’âme s’en va, est un meurtrier.(…) C’est comme une bougie en train de s’éteindre : qu’un homme mette le doigt dessus, elle s’éteint aussitôt. » (Chabbat 151, b).
Dans la mesure où la Tora interdit catégoriquement le suicide (4), il est clair que le fait de se donner soi-même la mort ou d’autoriser les autres à accomplir l’acte fatal par la rédaction d’un testament, comme le préconisent les partisans de l’euthanasie, ne modifie en rien les données du problème : pas plus qu’un autre homme le malade n’est réellement maître de son corps et de sa vie.
Dans cette perspective, il apparaît également qu’il est formellement interdit de cesser de fournir au malade sa nourriture, même si celle-ci doit être administrée par sonde ou intraveineuse, ainsi que tout autre besoin naturel et vital, tel que l’oxygène, et les médicaments de base, comme les antibiotiques. Malgré le caractère passif d’une telle euthanasie, son auteur serait néanmoins assimilé à un meurtrier, et comparable à celui qui fait mourir de faim sa victime (voir Maïmonide, Hilkhot Rotséa’h 3, 10). Ici encore, la volonté du patient ne modifie en rien la donne.(3)
Il importe pourtant de souligner que la loi juive distingue entre le fait de provoquer la mort, et celui de s’abstenir de recourir à des moyens thérapeutiques qui empêchent artificiellement l’âme du patient de quitter le corps sans lui apporter pour autant la moindre guérison. Il ressort ainsi des Responsa rabbiniques que s’il est catégoriquement défendu de débrancher des appareils déjà fixés sur un malade tant que celui-ci présente le moindre signe de vie, on n’a pas non plus à installer un système de réanimation chez un mourant incurable et en proie à de grandes douleurs (cas, par exemple, d’une personne atteinte d’un cancer généralisé et qui ne respire plus, ou dont le cœur a cessé de battre).
Il semble donc possible d’affirmer que si le judaïsme s’oppose à l’euthanasie proprement dite, il réprouve également « l’acharnement thérapeutique » dès lors que celui-ci entretient ou augmente la souffrance sans véritable espoir de guérison. Les nuances en ce domaine sont cependant très délicates, et demandent à être précisées au cas par cas, par les grands décisionnaires. Moins la prolongation de vie sera importante dans le temps, et moins on parviendra à juguler la souffrance, plus il sera licite, sauf avis contraire du malade lui- même, de s’abstenir de tout traitement que l’on peut qualifier « d’extraordinaire ». (5)
En résumé, dans la difficile confrontation entre le souci d’atténuer et de supprimer la souffrance, et l’interdit de supprimer la vie, primauté absolue doit être accordée à la vie sur la souffrance.
Mais s’agissant du droit à s’abstenir des soins qui dépassent le cadre des besoins naturels, c’est précisément la prise en compte de la douleur qui constitue le paramètre de la décision halakhique.
Très caractéristique également est la position des décisionnaires concernant l’administration de morphine aux grands malades, malgré le risque entraîné d’abréger la vie. Tout dépend de l’intention du praticien et de la dose prescrite. Si on vise explicitement à abréger la vie – dose toxique, et a fortiori létale- cela est catégoriquement interdit. Mais si on ne vise que le soulagement du patient – dose apaisante – cela est non seulement permis, mais recommandé, malgré le risque fatal encouru. Même si la mort survenait, la responsabilité du médecin (ou de l’infirmière) serait dégagée en vertu du principe de « l’acte non- intentionnel » – Davar chéèno mitkaven (6).
« Le médecin a le droit de guérir », affirme le Talmud (Baba Kama 86b) : il est au service de la vie. La « mort douce » ou la « belle mort » ne relèvent donc ni de sa compétence ni de la mission dont la Tora l’investit. « Plus que jamais il importe de rappeler aujourd’hui, dans une civilisation tentée par des solutions désespérées, l’absolu des principes moraux, et, avant tout, celui du respect de la vie humaine. Le judaïsme est une doctrine de vie, il est pour ainsi dire tout entier un hymne à la vie(…) Message d’optimisme, de courage, de foi et d’espoir en Celui qui donne la vie. » (7)
(1) Cf. supra Septième partie, chap.5
(2) Rabbi I. Jakobovits, Harefoua Vehayahadout (La médecine et le judaïsme), Jérusalem 1966.
(3) Rabbi S.Z. Auerbach, Min’hat Chelomo, chap.91, §24
(4) Cf. ‘Hatam Sofer, Yoré Déa, chap.326 et supra Septième partie, chap.6
(1) Cf. Igrot Moché, Yoré Déa, t.2, chap.174, 3è partie; ‘Hochen Michpat, t.2, chap.73-1 ,74-1,2, et3, 75-1. Rabbi S.Z. Auerbach et Rabbi Y.Sh. Elyachiv , cités dans Nichmat Avraham, t.2 Yoré Déa, p.153.
(6) Rabbi S.Z. Auerbach in Assia, n° 59-60. Cf. aussi Nichmat Avraham, Yoré Déa, p.246.
(1) E.Gugenheim, Le judaïsme dans la vie quotidienne II, Etudes et responsa (Albin Michel 2002).