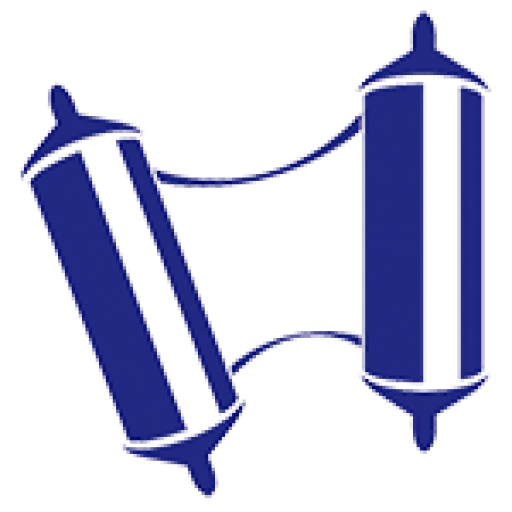Textes
L’enjeu des mots – Rabbin Mikaël Journo
Les fake news ont toujours existé. Elles ont pris une nouvelle dimension avec les réseaux sociaux, en permettant à n’importe qui de propager toutes sortes de rumeurs, de mensonges et d’horreurs.
Paradoxe de la démocratie, la liberté d’expression peut devenir un danger pour la vérité, le Emet], et donc une menace pour la démocratie. Un paradoxe sinistre… surtout quand des hommes politiques utilisent la technologie actuelle à des fins de conquête du pouvoir et pour faire triompher leurs convictions à n’importe quel prix.
Pourtant, sans moyen de communiquer nous sommes enfermés dans notre solitude, prisonniers de notre incapacité à partager avec l’autre des moments simples ou importants qui transcendent la vie quotidienne.
Selon Ésope ou Rabbi Yeoudah Hanassi, une langue est un système de communication neutre qui peut devenir la meilleure ou la pire des choses selon l’usage que l’on en fait ; elle peut être une source de beauté, mais aussi une arme destructrice quand elle sert à répandre la calomnie et la haine. On ne peut faire fi de la personnalité et des intentions de ceux qui s’expriment ni de ceux qui reçoivent l’information, car il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, quand il ne se livre pas à des interprétations très personnelles, ou absorbe sans recul tout ce qu’on lui dit.
Le judaïsme a très vite compris l’importance de l’apprentissage de la langue. Dès ses jeunes années, l’enfant apprend à lire, à connaître les textes – la Thora, les prières et leur signification – qui vont accompagner la vie juive. Cet apprentissage, source de connaissance et de discernement, a permis de maintenir et approfondir durant des millénaires un savoir qui a certainement contribué à la pérennité du peuple juif.
Nous savons que l’un des dangers qui menacent la démocratie est le fait que des individus utilisent la parole de façon dévoyée.
Il n’est alors pas question d’argumentation, de rigueur ni de réflexion, le langage verbal et gestuel sert à fragiliser et détruire ce bien commun qu’est la démocratie.
Dans la Thora, l’épisode au cours duquel Korah (Nombres, 16)] bafoue l’autorité de Moïse et d’Aaron est compris comme la volonté de saper l’autorité divine et celle de ses représentants afin d’accaparer tous les pouvoirs.
Les arguments utilisés par Korah, sortis de leur contexte, pourraient laisser penser que celui-ci cherche à servir le peuple par un art oratoire brillant.
La Paracha (section biblique) débute par ces mots : « Korah prit », sans que la Thora précise l’objet pris.
Selon l’un des commentaires de Rashi, « il prit les hommes par des paroles », en d’autres termes il les séduisit avec des mots.
Mais derrière la remise en cause de Moïse et de son autorité, il semble qu’avant toute chose il y ait chez Korah une volonté délibérée de s’approprier le pouvoir, et nullement dans l’intérêt du peuple d’Israël.
L’épisode de Korah nous invite à nous interroger sur l’utilisation du verbe à des fins de manipulation.
La démocratie, c’est-à-dire « l’art de conduire le peuple », fonctionne dans un espace politique où la parole est libre et s’exprime librement, contrairement aux régimes fascistes ou totalitaires, où la parole libre est confisquée. La volonté du pouvoir en place pèse alors sur le peuple, qui ne peut plus s’exprimer que par diverses formes de résistance. Mais la démagogie s’exerce dans le cadre d’une démocratie, et certains des pires dictateurs ont été élus démocratiquement.
Ceux qui utilisent le langage à des fins de manipulation entendent fragiliser et détruire le lien commun.
De nos jours, dans une démocratie, la menace d’une manipulation généralisée provient bien de ceux qui cherchent à séduire les populations pour les asservir.
Pour se faire élire ils n’hésitent pas à déformer la réalité et même à inventer des événements purement imaginaires. Les tribuns populistes excellent dans cet exercice.
L’éloquence est-elle nécessaire pour s’adresser aux autres ? Un poids pesait sur la bouche de Moïse et rendait son élocution difficile, pourtant c’est lui que Dieu a choisi pour transmettre sa Loi au peuple juif. Cette absence de don oratoire a-t-elle empêché le peuple d’adhérer à la Loi ? Korah ne s’est pas opposé à Moïse à cause de son déficit d’éloquence, mais surtout parce qu’il voulait se substituer à lui. Sans aucun doute, l’éloquence aide à convaincre, mais si elle sert l’apparence ou le mensonge, cette imposture verbale n’apportera que désillusion et chaos.
La parole doit être indissociable d’une éthique. Si elle sert le mal, choisissons le silence et gardons-nous d’écouter. L’éloquence doit inciter celui qui écoute à rester attentif et à accroître son intérêt, mais aussi à converser et, comme le rappelle l’étymologie de ce verbe, à mieux vivre ensemble.
La conscience de l’homme doit donc toujours être en éveil.
Il doit se méfier des paroles et des attitudes destinées à séduire et qui peuvent nous entraîner à croire à des promesses qui ne sont que bulles de savon.
Il ne s’agit pas de se méfier de tout, mais d’exercer toujours son esprit critique de manière à confronter les paroles à la réalité.
Dans le judaïsme, l’étude du Talmud encourage avec rigueur la réflexion, le savoir, le débat et l’argumentation.
Elle nous apprend à éviter de tomber facilement dans la séduction.
L’étude de la Thora est une invitation à l’échange. Le débat n’est pas le rejet de la pensée de l’autre, il est au contraire source de créativité et d’enrichissement.
Les débats de nos prédécesseurs se poursuivent avec nous et se poursuivront avec les générations futures..
La Menorah, symbole par excellence du Judaïsme et de l’état d’Israël – Rabbin Mikaël Journo
La Paracha Béaaloteha traite en premier lieu de l’allumage de la Mènora, le candélabre à 7 branches. Celle-ci était illuminée avec de l’huile d’olives.
N’est-ce pas parce que l’essence de l’huile d’olive évoque le symbole significatif du destin d’Israël, que celui-ci revêt au mieux une importance particulière pour la conservation de l’identité Juive ?
L’olivier et l’huile d’olive existent dans les références de nombreuses cultures et religions et portent toujours une valeur positive.
A titre d’exemple même dans la civilisation grecque l’olivier représente l’Emblème de la paix de la gloire et de la richesse.
Ainsi, lors des Jeux olympiques d’Athènes, les athlètes massaient leurs muscles avec de l’huile d’olive pour les rendre plus souples. En plus de la couronne de laurier, les vainqueurs des Jeux Olympiques étaient récompensés avec des branches d’olivier et des jarres d’huile d’olive !
Durant les chaudes journées, c’est à l’ombre d’un olivier qui se situait dans les jardins de l’école Aca démos d’Athènes, que Platon enseignait la philosophie à ses disciples.
L’olivier est souvent cité dans la Thora. L’épisode le plus connu concerne le rameau d’olivier que la colombe de Noé tient dans son bec, marquant la fin du déluge et symbolisant le pardon de D.ieu et la paix.
L’huile est utilisée pour l’allumage de la Menora (Exode 25, 6), pour la confection de certaines oblations offertes au Temple (Lévitique 2, 1), pour la louange de la terre d’Israël (Deutéronome 5, 15), pour l’onction des rois (I Samuel 16, 1), pour la consécration d’un objet destiné au service divin (Genèse 28, 18)… Nombreux sont celles et ceux qui ont l’habitude d’allumer les lumières de shabbat et de ‘hanoukka avec l’huile d’olive.
L’huile est suivant nos sages le symbole même de la différenciation et de l’identité spécifique du peuple Juif. « Les liquides se mélangent entre eux, tandis que l’huile ne se dissout pas, de même Israël conserve sa spécificité parmi les nations » (Exode Raba 36, 1). A cet égard, l’huile d’olive, symbole essentiel de la fête de Hanouka, incarne les valeurs du Peuple Juif, car même quand on veut les dissoudre, à l’instar de l’huile, elles sont indestructibles.
La délivrance d’Israël par le Messie, le Machiah celui qui sera oint avec de l’huile d’olive arrivera quand la nation juive suivra l’exemple de l’huile qui doit sauvegarder son patrimoine et son identité pour continuer à s’éclairer et à illuminer le monde (Deut Raba 7,3).
Car si l’huile se superpose aux autres liquides, ce n’est pas dans une volonté de domination mais dans une aspiration à l’élévation.
Écouter pour mieux voir – Rabbin Mikaël Journo
On dit volontiers de la civilisation occidentale qu’elle est celle de l’image. Le cinéma, la télévision et Internet justifient en partie cette assertion. Le flux d’images dans nos maisons et à l’extérieur est aujourd’hui quasiment ininterrompu.
Tout, autour de nous, semble vouloir traduire en images les gestes, les pensées, les actions et tout ce qui constitue l’existence, y compris la vie privée, qu’il s’agisse des YouTubeurs, des influenceurs ,des interfaces graphiques de nos smartphones (entre autres) et des services de la vie quotidienne.
On reconnaîtra cependant que dans de nombreux domaines, en particulier celui de la médecine, ces images servent l’humanité.
Mais l’image est devenue un outil de communication et d’expression, autant qu’un argument publicitaire qui a pour finalité la vente. En témoigne par exemple le logo marketing « Vu à la télé », apposé sur des produits de consommation pour décider à l’achat les plus hésitants.
Comment sommes-nous arrivés à ce triomphe de l’image ?
Dans la Grèce antique, où la dialectique était pratiquée pour faire avancer les débats d’idées, il semble que les philosophes regardaient les images avec une certaine circonspection. On pourrait en trouver un exemple avec le célèbre « mythe de la caverne » de Platon, qui nous enseigne que les images sont trompeuses et nous gardent prisonniers de nos illusions.
L’eidos n’est pas l’eidolon, les idées ne sont pas des images car elles ne peuvent être produites que par l’intelligence. Ce qui n’est pas le cas des images, qui véhiculent des opinions, émotions et sentiments, et sont le plus souvent dirigées par une intention. Créatrices d’illusion, les images exercent une force persuasive puissante qui joue sur nos mécanismes intérieurs, souvent peu connus de nous. Elles trouvent écho dans la partie irrationnelle, « humaine, trop humaine », selon Bergson, de notre âme.
Alors comment combattons-nous ces images envahissantes ? Par d’autres images ! Ce qui traduit le caractère incertain des opinions dont elles procèdent.
L’image apporte néanmoins de l’information, comme l’illustre « Le poids des mots, le choc des photos », slogan d’un magazine « d’actualités et d’images » bien connu.
Catherine Chalier, dans son livre Sagesse des sens, estime que la philosophie occidentale valorise le sens de la vue tandis que la tradition hébraïque privilégie celui de l’ouïe. Car, dit l’auteur, « Lorsque les hommes sont attentifs à l’appel de Dieu, ils doivent renoncer à le voir et à le représenter ».
La tradition juive a de tout temps pris ses distances avec l’image.
La seconde Parole du Décalogue enjoint à l’homme de ne pas adorer d’image, quelle qu’elle soit, mais de privilégier le sens de l’ouïe : « Écoute Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un » (Deutéronome 6,4).
« Tout le peuple vit les voix. » Selon Emmanuel Levinas, ce célèbre verset lié au don de la Thora, loin de constituer une atteinte au bon sens, signifie « entendre l’audible, entendre un dire, ne plus chercher l’inconnu sous des formes visibles, ne plus les saisir comme image ».
Car voir l’audible, conclut Levinas, « ce serait la voix devenue écriture ! ».
Le langage parlé (la Thora orale) et le langage écrit (la Thora écrite) invitent à prendre le temps de les passer au crible de nos facultés critiques.
Prendre le temps de l’étude, de l’analyse, permet de se faire une opinion « à froid », c’est-à-dire avec distance, à la différence de l’image.
Néanmoins, condamner l’image reviendrait à s’enfermer dans un dogme et une « vision » intellectuelle restreinte.
Pour comprendre le monde et le message divin, nous avons besoin de la totalité de nos sens, à condition de les filtrer par la raison.
L’image n’est ni bonne ni mauvaise en soi, c’est l’utilisation que nous en faisons qui suscite l’inquiétude. Car une pensée ou une parole peut avoir une charge aussi malfaisante qu’une image.
Pessah ou la liberté guidant les peuples – Rabbin Mikaël Journo
L’Exode, ou la fuite d’Égypte des enfants d’Israël, est l’événement fondateur de l’identité d’Israël en tant que peuple. À tel point que la Torah le mentionne à plus de cent soixante reprises ! Le chabbat mais également de nombreuses lois et fêtes du calendrier hébraïque rappellent la sortie d’Égypte.
Pour Rabbi Yeoudah Halévy, auteur du Kouzari, si la tradition juive accorde tant d’importance à cette libération, c’est parce qu’elle témoigne de l’intervention divine dans l’histoire des hommes. Ce point de vue contredit celui qui affirme l’existence d’un Dieu créateur qui refuserait d’intervenir dans les affaires humaines. On peut noter que lors du Kidouch du vendredi soir, le Juif rappelle que l’Éternel a créé le monde en six jours et a libéré les enfants d’Israël de la servitude en Égypte.
En d’autres termes, Il est à la fois le Dieu créateur de l’univers et le Dieu libérateur des hommes. Cette liberté acquise n’a pas pour finalité un monde où tout serait permis et qui conduirait inéluctablement à une nouvelle forme d’aliénation, mais une liberté qui s’organise autour de la Loi, volontairement acceptée.
Pessah symbolise la liberté non seulement pour les Juifs, mais également pour de nombreux peuples. Michael Walzer, philosophe américain, le souligne dans son ouvrage De l’Exode à la liberté. La sortie d’Égypte, observe-t-il, est devenue au fil du temps un exemple significatif de libération des peuples. Ce récit est original en ce sens qu’il tranche avec les récits antiques de voyages telle l’Odyssée des Grecs, cette longue errance que décrit Homère.
Selon Michael Walzer, la singularité de cette libération réside dans le fait qu’elle est un mouvement « de l’esclavage, l’exploitation et l’aliénation en Égypte vers une terre où les hommes puissent vivre dans leur dignité d’hommes ». Il ajoute que « la leçon politique de l’Exode, de l’oppression de Pharaon et de la délivrance vit encore en nous, puissants souvenirs qui modèlent notre perception du monde politique ».
Ainsi de nombreux peuples et de nombreuses nations ont-ils été inspirés et encouragés à briser les chaînes de l’oppression, qu’elle soit politique, sociale ou religieuse. C’est ce que nous enseigne ce célèbre Midrash : « Lorsque la mer des Joncs s’est ouverte, toutes les mers du monde se sont ouvertes. » La liberté offerte à Israël l’était également pour les autres peuples.
À notre connaissance, c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que l’on recense un acte de libération collective, où tout un peuple est affranchi de sa condition servile et acquiert son statut d’hommes libres, de peuple libre.
Il est vrai qu’à Rome, les esclaves se sont révoltés à plusieurs reprises, notamment ceux qui ont suivi Spartacus, ancien gladiateur. Mais ces révoltes furent des échecs.
La famille de Jacob s’est vue privée durant une très longue période de tout ce qui donne à un homme son statut d’homme et à un peuple son statut de peuple, c’est-à-dire une terre, la dignité, la liberté. Le message de la sortie d’Égypte s’adressait à elle et à tous les peuples – un message permanent et sans cesse renouvelé.
Pourim – Rabbin Mikaël Journo
En cette veille de Pourim, j’aimerais vous transmettre un message plein de vie et de confiance en l’avenir, malgré la situation difficile que nous traversons.
Pourim est une fête singulière : elle montre combien le destin n’est jamais écrit d’avance. Elle raconte un projet d’anéantissement orchestré par les ennemis du peuple d’Israël, qui a échoué grâce à l’intelligence d’une nation qui a appris à s’unir face à l’adversité.
Dans la Meguila d’Esther, Aman, le conseiller d’Assuérus menace le peuple d’Israël sans jamais le nommer. Il décrit un peuple qui ne respecte pas la loi monarchique, mais surtout « un peuple éparpillé, dispersé ». Le Rabbi de Gour souligne que la communauté était doublement divisée, sur le plan géographique, mais aussi sur le plan spirituel. C’est la raison pour laquelle lorsque la reine Esther apprend la menace de destruction qui pèse sur les Juifs, elle propose avec ingéniosité une prière et un jeûne collectif sur la place publique : il s’agit de recréer le lien distendu.
Ce message d’unité transparaît aussi dans les 4 Mitsvot de Pourim : la lecture de la meguila se fait en communauté, pour montrer que nous sommes tous interdépendants, qu’un projet réussi doit être collectif. La Mitsva de matanot laevyonim, qui consiste à offrir des cadeaux aux pauvres, nous oblige à aller à la rencontre de l’autre, à dépasser nos penchants individualistes. Le Michté, ce repas fastueux que nous partageons, nous permet de nous réunir avec nos familles ou notre communauté. Les Michloah Manot, cet échange de mets préparé avec soin, est encore plus parlant.
Toutes ces Mitsvot nous rappellent les valeurs de fraternité, de paix et d’amitié et nous enseignent que lorsque le peuple d’Israël est uni, rien ni personne ne peut l’atteindre. Voilà la morale de Pourim : il nous faut resserrer les liens et rester proches, quel que soit notre niveau de pratique religieuse, notre philosophie, ou notre façon d’agir.
En cette période difficile, il nous faut continuer à croire en D.ieu et en l’avenir et à espérer en l’homme.
J’ai une pensée pour nos malades qui souffrent dans les hôpitaux, les personnes isolées, les plus faibles qui n’ont parfois pas la chance de pouvoir partager ces fêtes avec un être cher. Aussi , avec l’ensemble des aumôniers israélites des hôpitaux, nous sillonnerons les principaux hôpitaux de France afin de lire la Meguila et distribuer des Michloah manot. Nous sommes ensemble.
Rebelles pour la bonne cause
Peut-on dire que des personnages de la Torah ont exercé un rôle dans la vie juive qui les a mis en contradiction avec l’ordre établi, voire – ce qui est plus surprenant – les a amenés dans certains cas à s’opposer à la volonté de Dieu ?
Certains de nos ancêtres, dans des moments particulièrement douloureux de l’histoire du peuple juif, se sont dressés contre les systèmes et le pouvoir existants et parfois même contre les décrets divins.
Il faut du courage à Abraham pour s’opposer à une société polythéiste, et cela d’autant plus que son père commercialisait des idoles.
À partir d’une méditation profonde, il découvre le monothéisme et entre en rébellion contre son père et le pouvoir en place. Or il n’était pas sans risques pour lui de contester l’ordre établi.
La Torah décrit Abraham comme un homme perpétuellement en marche. Envers et contre tout, il poursuit son chemin, surmonte les épreuves.
C’est pourquoi la Torah accole à son nom l’adjectif IVRI (« Celui qui avance ») (Genèse 14,13). L’Hébreu est celui qui est de l’autre côté, celui qui est en marge.
Si l’on excepte l’épisode de la ligature d’Isaac (appelée aussi à tort sacrifice d’Isaac), Abraham n’aura de cesse de tenter de négocier avec Dieu le pardon pour ses contemporains.
Abraham n’est jamais indifférent au sort des autres, il les aide, hommes et femmes, quand bien même ils ont failli. Il n’est jamais insensible à l’humanité.
L’identité du patriarche est double, comme l’est son nom.
Il est Abram, le premier père du peuple juif, et Abraham, dont la vocation se veut universelle.
Figure de dialogue et d’ouverture, Abraham deviendra l’ancêtre commun des trois religions monothéistes.
Le cas de Moïse est différent, après son sauvetage miraculeux des eaux du Nil par la fille de Pharaon.
Il aurait pu se contenter égoïstement et avec condescendance d’être prince d’Égypte.
Mais lorsqu’il voit la souffrance des Hébreux esclaves, « il sort vers ses frères » (Exode 2,11), quitte sa condition privilégiée. Solidaire des peines de ses frères, il prend leur défense, ce qui l’amène à tuer un contremaître égyptien qui maltraite à mort un esclave hébreu.
Par son acte, il commet une transgression qui lui fait perdre sa condition royale.
Moïse prend conscience à ce moment que ces esclaves sont ses frères et qu’aucune situation privilégiée ne peut résister à l’appel de la justice.
Deux épisodes de la Torah témoignent de ce que Moïse n’accepte pas l’injustice : lorsqu’il voit un esclave hébreu qui frappe son prochain, il s’interpose ; lorsqu’il voit les filles de Jéthro brutalisées par des bergers, il intervient pour les protéger.
Moïse ne reste jamais indifférent, il ne supporte ni l’iniquité ni l’arbitraire. Il agit pour rétablir la justice.
Dieu le choisit comme guide du peuple juif, entre autres à cause des engagements qu’il a pris en refusant les abus et les violences injustes.
En d’autres occasions, comme Abraham, Moïse n’hésitera pas à engager un débat difficile avec Dieu pour défendre ses contemporains fautifs.
Ces deux personnages fidèles au message divin aiment leur peuple et le témoignent, quand bien même ce dernier manque à ses devoirs. Ils se font l’avocat de sa cause.
D’autres civilisations connaissent des héros qui se révoltent pour apporter un bienfait à l’humanité. C’est le cas de Prométhée, qui dérobe aux dieux le feu au profit des hommes, quitte à s’opposer à Zeus qui déchaînera contre lui son courroux.
Il ne s’agit pas là d’un dialogue avec le divin, mais d’un combat sans merci.
Mais d’autres rebelles existent qui, sous prétexte de combattre l’ordre établi, multiplient provocations et sarcasmes et recherchent plutôt leur intérêt personnel.
Si l’on se réfère à la Haggadah de Pessah (récit de la sortie d’Égypte), parmi les quatre enfants qui s’interrogent sur la fête de Pessah se trouve le Racha, le méchant, dont le rôle peut être interprété comme celui qui refuse de réfléchir et d’apprendre le sens de l’événement. Le Racha s’en détache avec une ironie mordante, s’opposant au peuple juif et se moquant de lui. Il choisit ainsi de s’en exclure, sans se soucier du sort de celui-ci.
Le Racha peut nous faire penser à ces Juifs qui ne se souviennent de leur judaïté que pour la nier, la combattre, allant même jusqu’à s’allier avec les ennemis acharnés à la perte du peuple juif.
L’odeur de l’honnêteté – Rabbin Moshé Sebbag
La Torah dans Parachat Toldot raconte l’histoire de la bénédiction que Isaac souhaitait conférer à son fils aîné, Ésaü mais qu’il finit par accorder au fils cadet, Jacob, après que Rivka ait fait venir Jacob devant Isaac- qui était aveugle – déguisé en Esaü. Jacob se présenta devant Isaac en portant les vêtements d’Esaü, qui, apparemment, dégageaient un arôme distinct, car lorsque Isaac embrassa Jacob, il sentit les vêtements et s’exclama : « Voici, le parfum de mon fils est comme le parfum d’un champ béni par le Seigneur » (27:27).
La Gemara dans traité Sanhedrin (37a) suggère de lire le mot « bégadav » (« vêtements ») dans ce verset comme « Bogdav » – « ses Trahison », de sorte que la Torah fait ici allusion aux pécheurs parmi les descendants de Jacob. YIsaac avait prévu que la nation qui descendrait de son fils ne produirait pas un petit nombre de « Bogdim » – ceux qui ne respectent pas les valeurs et les traditions du peule d’Israël. Et pourtant, Isaac a proclamé que même ces membres des enfants d’Israël émettent un « parfum », car, comme le commente la Gemara, » même les personnes qui ne connaisses pas leurs religion » parmi le peuple juif sont « remplis de mitzvot. »
Le Rav Leibele Eiger, dans Torat Emet, explique que les commentaires de la Guemara se concentrent sur Jacob lui-même. À ce moment-là, lorsque Jacob- bien que contre sa volonté – s’est présenté devant son père sous un déguisement, dans le but de le tromper, il a eu le sentiment d’être un « Bogéd » – d’avoir trahi Isaac. Il se sentait brisé et angoissé, souhaitant ne pas avoir à subir cette mascarade. Et ces sentiments d’angoisse, suggère qu’ils dégageaient un beau parfum.
Rav Leibele écrit : » Lorsqu’il est venu vers son père avec ce cœur brisé, l’odeur de son cœur brisé s’est élevée… Tout comme les arbres parfumés – lorsque le bois est brisé, l’odeur se répand plus fortement, de la même manière, à travers la rupture du cœur de Jacob… Isaac ‘sentait’ l’essence de la sainteté de Jacob. « Le « parfum » que Isaac a senti était le « parfum » du cœur brisé de Jacob, son angoisse face à l’acte de tromperie qu’il commettait.
Cet aperçu hassidique enseigne que l’humilité authentique a un certain effet « odorant » que les gens trouvent attrayant. Nous sommes naturellement dégoûtés par l’arrogance et l’excès de confiance, et nous avons tendance à nous sentir plus à l’aise avec ceux qui sont humblement conscients de leurs défauts et de leurs lacunes, qu’ils ne tentent pas de cacher par une façade d’assurance. Ainsi, alors que nous pouvons penser que nous pouvons impressionner les autres et gagner leur respect en paraissant confiants, fiers et sûrs d’eux, en vérité, nous sommes bien plus « parfumés » lorsque nous nous conduisons avec une honnête conscience de nous-mêmes, avec une reconnaissance claire de nos forces et de nos faiblesses, de nos succès et de nos échecs. C’est précisément lorsque nous n’essayons pas de nous mettre en avant dans le but d’impressionner que nous dégagions un « parfum » agréable grâce auquel nous avons plus de chances de gagner l’admiration et la faveur des autres.
La pluie à Souccot
La Michna de traité Soucca (28b) aborde la situation des pluies à Souccot, en établissant qu’une fois que la nourriture d’une personne commence à être ruinée par la pluie, elle peut quitter la Soucca (cabane) et entrer dans sa maison. La Michna ajoute ensuite qu’une telle situation est comparable à celle d’un « serviteur qui vient verser une tasse pour son maître, le maître prend une cruche et lui verse sur le visage ».
Il semble clair que nos sages font ici référence au mécontentement de Dieu à l’égard de notre service, puisqu’il fait pleuvoir pour nous empêcher d’accomplir la mitsva de soucca, mais le scénario précis décrit, et la signification particulière de cette analogie, nécessitent une explication.
Le Gaon de Vilna ( Eliyahou ben Chlomo Zalman, Le Génie de Vilna, simplement par son acronyme hébraïque HAGRA (HaGaon Rabbénou Eliyahu (23 avril 1720 – 9 octobre 1797)), a offert une interprétation particulièrement perspicace de la Mishna, expliquant que le maître dans l’analogie ne verse pas sur le serviteur la coupe qu’il lui a été donné de boire. La Mishna parle d’un serviteur venant « Li-mzog », qui est souvent utilisé par nos sages en référence à la dilution du vin. Le vin est brut et non traité, et le serviteur apporte une cruche d’eau à verser dans le vin pour que le maître puisse le boire. Le maître jette ensuite l’eau sur le serviteur, rejetant son geste, et laissant le vin non traité et donc imbuvable. La Gaon de vilna a expliqué que cette analogie fait référence à la nécessaire combinaison entre les expériences très différentes des Yamim Noraim (jours redoutables entre Rosh Hachana à yom Kippour) et de Souccot. Le vin de cette histoire représente la crainte, la crainte et l’intensité spirituelle des dix premiers jours de Tichrai, entre Rosh Hachana à yom Kippour, la période de jugement, d’introspection, de tension et d’effroi. Ce « vin » ne peut être correctement absorbé et intégré dans notre être sans être « dilué » par l’ajout de la joie et de la fête de Souccot. L’expérience du mois de Tichrai n’a de sens et d’impact que si nous combinons le « vin » et l' »eau » – l’intensité et la solennité du Yamim Noraim avec la célébration festive de Souccot. Sans la joie de Souccot, l’expérience du Yamim Noraim ne peut pas avoir un impact durable sur nous. Nous reprendrions simplement notre routine ordinaire et laisserions derrière nous les émotions spéciales et intenses des grandes fêtes, car nous serions incapables de les apporter avec nous dans notre vie quotidienne. C’est la joie de Souccot qui « dilue » la peur de Rosh Hachana et de Yom Kippour afin que l’expérience puisse être correctement intégrée dans notre vie quotidienne tout au long de l’année à venir.
Nous comprenons l’intention de la Michna en présentant cette analogie. Lorsque Dieu, pour des raisons que nous ne pouvons pas connaître, fait pleuvoir à Souccot, nous empêchant ainsi d’accomplir la Mitsva de Souccot, nous perdons l' »eau » dont nous avons besoin pour « diluer » l’expérience de Yamim Noraim. Nous courons alors le risque de perdre l’effet à long terme de cette expérience sur notre vie.
Selon le Gaon de Vilna, cette Michna nous enseigne donc l’importance de l’équilibre délicat entre la peur et la joie, entre une concentration spirituelle intense et un bonheur et une joie authentiques. Cette combinaison nous permet de vivre une vie religieuse riche et significative, dans laquelle nous travaillons pour servir notre Créateur avec à la fois solennité et joie, en remplissant nos obligations avec sérieux et intensité tout en jouissant d’un vrai contentement et d’une vraie satisfaction.
Trouver un équilibre de notre appréciation de la richesse – Rabbin Moshé Sebbag
La Torah dans le Sefer Devarim (16:13) ordonne d’observer la fête de Souccot « be-ospékha mi-gorénkha ou-mi’kvekha » – « quand tu recueilles [les produits] de ton grenier et de ta presse ». La signification de ce verset est que Souccot est célébrée au moment de l’année où la récolte est terminée, après que les produits aient été collectés et stockés. Le Talmud, cependant, dans le traité Soucca (12a), offre une interprétation surprenante de ce verset qui constitue la base de l’une des lois les plus fondamentales et les plus importantes concernant la Soucca. En effet, le talmud déduit de ce verset que le sékhakh, l’élément principal de la soucca, doit être fait de « pesolet gorén vé-yékèv » – « les déchets du grenier et de la presse ». En d’autres termes, le sékhakh doit être fait de végétation, mais de « pesolet » – les déchets, un matériau qui ne peut être mangé ou utilisé à des fins constructives.
Le Talmud explique brièvement comment nos sages est arrivé à cette conclusion sur la base de ce verset, mais quoi qu’il en soit, il est frappant que le sekhakh soit décrit en de tels termes. La fête de Souccot célèbre les produits du « grenier et de la presse », la récolte fructueuse qui vient d’être récoltée, rassemblée et stockée pour l’hiver. Et, selon la lecture de du Talmud, la Torah commande de célébrer ce pays dans une structure faite spécifiquement à partir du ‘’pesolet’’ – les déchets qui sont jetés pendant le processus de récolte. Nous célébrons et rendons grâce pour la nourriture que nous avons produite en résidant dans une habitation faite de matériaux non utilisables produits par les champs. Il semble que la Torah cherche à détourner l’attention du fermier de la nourriture qu’il vient de produire, et à prendre note du ‘’pesolet’’, ces tas de déchets qui se sont formés au cours du processus.
Comme la Torah l’indique explicitement ailleurs, dans le livre de Vayikra (23:43), la soucca commémore les conditions dans lesquelles les enfants d’Israël ont vécu pendant leurs séjour dans le désert. À la fin de la saison des récoltes, lorsque les entrepôts sont remplis de nourriture produite par les gens, grâce à leur travail acharné et à leur ingéniosité, on leur dit de se souvenir de l’expérience de leurs ancêtres dans le désert. On leur rappelle l’époque où notre nation était incapable de survivre par des moyens naturels, par le travail agricole, et était miraculeusement soutenue par le Tout-Puissant, ce qui renforce leur conviction que malgré leur travail et leurs efforts, leur subsistance dépend en fin de compte uniquement de Dieu. Dans le cadre de cette expérience, la Torah détourne notre attention de la nourriture que nous avons produite et la porte sur le « pesolet ». On nous rappelle que, comme Moshé l’a dit au peuple d’Israël en réfléchissant à leur survie surnaturelle dans le désert, « …une personne ne vit pas seulement de pain, mais plutôt de tout ce qui est déclaré par le Seigneur » (Devarim 8:3). Après que la nourriture ait été produite et collectée dans le grenier et la presse, la Torah nous dit d’utiliser spécifiquement le déchet, pour nous rappeler que du point de vue de Dieu, les déchets sont tout aussi précieux et significatifs que la nourriture. Dieu peut prendre soin de nous avec le « pesolet » (déchets) tout autant qu’il le peut avec les produits eux-mêmes.
C’est peut-être la signification de l’exigence du « pesolet goren vé-yékev ». Elle nous met au défi de trouver un équilibre entre notre appréciation de la richesse matérielle et la conscience de notre dépendance à l’égard du Tout-Puissant, tout en réalisant qu’en fin de compte, c’est Lui qui nous soutient et que c’est sur Lui que nous devons compter, plus que sur nos biens matériels.
Korah où l’enjeu des Mots/Maux – Rabbin Mikaël Journo
Les fake news, « infox » en français, ont toujours existé. Elles ont pris une nouvelle dimension avec les réseaux sociaux et les progrès technologiques, en permettant à n’importe qui de propager toutes sortes de rumeurs, de mensonges et d’horreurs.
Paradoxe de la démocratie, la liberté d’expression peut devenir un danger pour la vérité, le Emet , et donc une menace pour la démocratie. Un paradoxe sinistre… surtout quand des hommes politiques utilisent la technologie actuelle à des fins de conquête du pouvoir et pour faire triompher leurs convictions à n’importe quel prix.
Pourtant, sans moyen de communiquer nous sommes enfermés dans notre solitude, prisonniers de notre incapacité à partager avec l’autre des moments simples ou importants qui transcendent la vie quotidienne.
Selon Ésope ou Rabbi Yeoudah Hanassi, une langue est un système de communication neutre qui peut devenir la meilleure ou la pire des choses selon l’usage que l’on en fait ; elle peut être une source de beauté, mais aussi une arme destructrice quand elle sert à répandre la calomnie et la haine. On ne peut faire fi de la personnalité et des intentions de ceux qui s’expriment ni de ceux qui reçoivent l’information, car il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, quand il ne se livre pas à des interprétations très personnelles, ou absorbe sans recul tout ce qu’on lui dit.
L’analphabétisme est source de danger car il prive des moyens d’exprimer son ressenti et conduit à se sentir rejeté de la société et à vouloir lui nuire. L’actualité en fournit de nombreux exemples.
Le judaïsme a très vite compris l’importance de l’apprentissage de la langue. Dès ses jeunes années, l’enfant apprend à lire, à connaître les textes – la Thora, les prières et leur signification – qui vont accompagner la vie juive. Cet apprentissage, source de connaissance et de discernement, a permis de maintenir et approfondir durant des millénaires un savoir qui a certainement contribué à la pérennité du peuple juif.
Nous savons que l’un des dangers qui menacent la démocratie est le fait que des individus utilisent la parole de façon dévoyée.
Il n’est alors pas question d’argumentation, de rigueur ni de réflexion, le langage verbal et gestuel sert à fragiliser et détruire ce bien commun qu’est la démocratie.
Dans la Thora, l’épisode au cours duquel Korah (Nombres, 16) bafoue l’autorité de Moïse et d’Aaron est compris comme la volonté de saper l’autorité divine et celle de ses représentants afin d’accaparer tous les pouvoirs.
Les arguments utilisés par Korah, sortis de leur contexte, pourraient laisser penser que celui-ci cherche à servir le peuple par un art oratoire brillant.
La Paracha (section biblique) débute par ces mots : « Korah prit », sans que la Thora précise l’objet pris.
Selon l’un des commentaires de Rashi, « il prit les hommes par des paroles », en d’autres termes il les séduisit avec des mots.
Mais derrière la remise en cause de Moïse et de son autorité, il semble qu’avant toute chose il y ait chez Korah une volonté délibérée de s’approprier le pouvoir, et nullement dans l’intérêt du peuple d’Israël.
L’épisode de Korah nous invite à nous interroger sur l’utilisation du verbe à des fins de manipulation.
La démocratie, c’est-à-dire « l’art de conduire le peuple », fonctionne dans un espace politique où la parole est libre et s’exprime librement, contrairement aux régimes fascistes ou totalitaires, où la parole libre est confisquée. La volonté du pouvoir en place pèse alors sur le peuple, qui ne peut plus s’exprimer que par diverses formes de résistance. Mais la démagogie s’exerce dans le cadre d’une démocratie, et certains des pires dictateurs ont été élus démocratiquement.
Ceux qui utilisent le langage à des fins de manipulation entendent fragiliser et détruire le lien commun.
De nos jours, dans une démocratie, la menace d’une manipulation généralisée provient bien de ceux qui cherchent à séduire les populations pour les asservir.
Pour se faire élire ils n’hésitent pas à déformer la réalité et même à inventer des événements purement imaginaires. Les tribuns populistes excellent dans cet exercice.
L’éloquence est-elle nécessaire pour s’adresser aux autres ? Un poids pesait sur la bouche de Moïse et rendait son élocution difficile, pourtant c’est lui que Dieu a choisi pour transmettre sa Loi au peuple juif. Cette absence de don oratoire a-t-elle empêché le peuple d’adhérer à la Loi ? Korah ne s’est pas opposé à Moïse à cause de son déficit d’éloquence, mais surtout parce qu’il voulait se substituer à lui. Sans aucun doute, l’éloquence aide à convaincre, mais si elle sert l’apparence ou le mensonge, cette imposture verbale n’apportera que désillusion et chaos.
La parole doit être indissociable d’une éthique. Si elle sert le mal, choisissons le silence et gardons-nous d’écouter. L’éloquence doit inciter celui qui écoute à rester attentif et à accroître son intérêt, mais aussi à converser et, comme le rappelle l’étymologie de ce verbe, à mieux vivre ensemble.
La conscience de l’homme doit donc toujours être en éveil.
Il doit se méfier des paroles et des attitudes destinées à séduire et qui peuvent nous entraîner à croire à des promesses qui ne sont que bulles de savon.
Il ne s’agit pas de se méfier de tout, mais d’exercer toujours son esprit critique de manière à confronter les paroles à la réalité.
Dans le judaïsme, l’étude du Talmud encourage avec rigueur la réflexion, le savoir, le débat et l’argumentation.
Elle nous apprend à éviter de tomber facilement dans la séduction.
L’étude de la Thora est une invitation à l’échange. Le débat n’est pas le rejet de la pensée de l’autre, il est au contraire source de créativité et d’enrichissement.
Les débats de nos prédécesseurs se poursuivent avec nous et se poursuivront avec les générations futures.
Chéla’h Lekha : De la liberté d’expression à sa perversion – Rabbin Mikaël Journo
Pour nombre d’entre nous, la liberté d’expression est l’un des symboles les plus significatifs de la démocratie.
Elle permet d’exercer son droit de critique vis-à-vis des systèmes établis et des organisations politiques.
La liberté d’expression est invoquée en toutes circonstances, Voltaire, entre autres, faisant office de référence. Mais on ne réfléchit pas aux conséquences qu’elle produit et cette conquête démocratique se transforme trop souvent en désastre et en instrument d’oppression.
D’emblée, la liberté d’expression apparaît comme un fondement du débat et de la confrontation d’idées. Mais sans règles du jeu, elle peut en effet déboucher sur une manipulation généralisée et donner le pouvoir à ceux qui s’en prévalent… et qui la suppriment à la première occasion. Toute innovation, quel qu’en soit le domaine, génère du bien mais aussi du mal, comme dans une dialectique infernale.
L’évolution des technologies de communication (Internet, réseaux sociaux) peut mettre en difficulté ceux qui s’exposent.
La multiplicité des sites Internet qui utilisent la haine et le mensonge comme fonds de commerce trouvent de l’audience auprès d’esprits faibles, séduits par des assertions insidieuses qui font appel à l’émotion sans se soucier de la raison. Dans le contexte de notre Paracha, la stigmatisation de la terre d’Israël est verbalisée par des princes d’Israël !
La parole et le langage sont aux fondations du judaïsme. La parole structure des événements qui bâtissent la pensée juive.
Le langage nous relie les uns aux autres, pour le meilleur et pour le pire. Il nous réserve parfois des surprises. Une parole spontanée peut en effet livrer des vérités qui surprennent tant celui qui les entend que celui qui les dit.
Mais la parole, comme l’a énoncé Benjamin Gross, peut aussi se faire absente, détournée, refusée. Lorsqu’elle devient perverse, il faut s’en méfier. Si elle sert des ambitions extravagantes, mieux vaut la tenir à distance. Selon certains commentaires les princes craignaient que leurs privilèges soient menacés par l’entrée en terre d’Israël avec l’accès à une émancipation aboutie.
Le passage dans la Paracha Chela’h lekha relatif aux Tsitsit nous oblige à chercher un lien entre la faute des explorateurs constituée par la médisance sur la terre d’Israël et le texte des Tsitsit. Selon le Talmud, c’est le long fil d’azur des Tsitsit qui vient élever le regard de l’homme car il rappelle la mer, la mer qui elle-même nous incite à nous souvenir du firmament et le firmament qui va nous guider vers le trône de la gloire.
La couleur azur vient donc rappeler à l’homme qu’il peut être un créateur qui veille sur le monde et qu’il lui faut regarder le monde sans s’égarer de manière superficielle, futile, vaine et malveillante. Les explorateurs ont réalisé de la médisance au sujet d’une terre qu’ils avaient explorée. Le terme « explorer » en hébreu, est celui-là même dont la Thora va user pour marquer l’égarement des yeux dans le passage des Tsitsit. Une exploration superficielle menant à l’égarement du regard. Les explorateurs ne se sont pas contentés de regarder, ils ont accompagné ce regard de leur rapport personnel, de leur interprétation de ce constat visuel. Comment se mesurer à une telle menace ? c’est ainsi que par le pouvoir de la parole, ils ont entrainé le peuple dans la spirale de la panique. Quand la liberté d’expression n’est qu’un prétexte pour menacer et éliminer ceux qui pensent différemment, elle met en péril toute cohésion sociale. Elle n’est qu’un faux semblant, un travestissement.
Le judaïsme considère que la parole est un bien trop précieux pour l’utiliser à des fins nuisibles et qu’il faut la manier avec prudence et circonspection, comme le dit le proverbe : « La bouche du juste est une source de vie, celle du méchant recèle la violence » (Proverbes 10,11). Nous savons aussi, comme l’enseignait Rav Nahman de Breslev, que « la parole à elle seule peut faire taire le fusil ».
Un monde pacifié n’existe pas encore. On devra donc se méfier de toute forme de manipulation véhiculée par le langage et qui revendique la liberté d’expression, quitte à la faire disparaître ensuite. Au lieu de cela, proposons une parole fondée sur l’humanisme, la loyauté et la bienveillance. C’est une utopie certes, à la réalisation encore lointaine, mais qui peut faire partie dès ce lundi de notre projet de vie communautaire.
Behaalotkha : Les leçons de la complainte – Rabbin Mikaël Journo
Dans la paracha Behaalotkha que nous lirons ce chabbat, nous découvrons la complainte des Hébreux exprimée à l’égard de leur dirigeant spirituel, Moïse. Cette même génération de celles et ceux qui ont été témoins des miracles de la sortie d’Egypte comme la traversée de la Mer rouge et toutes sortes de merveilles réalisées par D.ieu, se montre dans une terrible affliction. Ils disent regretter amèrement le confort de l’Egypte.
Au chapitre XI, on apprend que le peuple ne cesse de se plaindre, il gémit, crit en direction de Moïse, en s’exclamant ainsi, « Qui nous donnera à manger de la viande… Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Egypte », et d’évoquer toute une liste d’aliments qu’ils consommaient en Egypte. Le texte regorge de moult détails en termes d’alimentation qui donnent l’impression que les enfants d’Israël sont dans une forme de syndrome de Stockholm, en évoquant avec nostalgie un enfermement ancien qu’ils perçoivent désormais comme favorable. Lorsqu’on regarde attentivement comment se déploie la révolte des enfants d’Israël, leurs premières plaintes donnent l’impression qu’elle n’est pas directement liée à une sensation de faim ou de soif, mais plutôt à un deuil. En première étape, ils ne font qu’exprimer une sorte de vague à l’âme, une colère face à un désert qui leur est hostile et qui trouble l’équilibre qu’ils avaient pu constituer dans l’univers carcéral égyptien.
Selon les commentaires de Rachi, cette expression populaire incarne l’idée qu’ils désirent s’arrêter, se reposer des désagréments des voyages dans le désert, qu’ils ressentent une fatigue, une tourmente. Ils sont dans l’incapacité de comprendre que le désert pourrait être un parcours pédagogique leur ouvrant l’accès à Israël, une terre hostile qui nécessitera aussi un effort d’apprivoisement. Ils ne comprennent pas l’utilité de telles pérégrinations et se disent : tout ça pour ça ? Quitter des souffrances pour en retrouver d’autres ?
En somme, ils se persuadent que ce D.ieu libérateur n’en était pas un mais une autorité exigeante se substituant au Pharaon, monarque absolu. Ils n’acceptent pas les épreuves auxquelles ils sont confrontés dans ce cheminement, ils ne perçoivent pas l’idée qu’il faudra se battre, réaliser des efforts pour avoir le mérite d’entrer en terre d’Israël.
C’est dire l’état d’insatisfaction qui régnait parmi les enfants d’Israël. Au point de vouloir gémir, s’exprimer dans la complainte. Ils s’expriment aussi, étonnamment, au futur : selon les commentateurs ils parlent de l’Egypte comme un futur possible, dans un état d’esprit de résignation et de dépression, au point de renier la liberté acquise parce que celle-ci,au sens de la tradition juive, ’est une liberté encadrée par la loi, mais eux préfèrent être libérés de toute emprise morale. Il y a donc tout lieu de croire qu’ils se sont affligés, cherchant une cause à un conflit qu’ils souhaitaient non pas juste contre Moïse mais d’une certaine manière contre D.ieu. C’est l’état d’esprit qui règne au moment où les enfants devaient se préparer à entrer en terre d’Israël. Un tel état d’impréparation et d’immaturité donnant l’impression d’une régression. Ce sont toutes ces questions qui doivent nous amener à réfléchir sur nos acquis en terme de spiritualité, de liberté, de maturité. Il nous appartient de préserver ces acquis et de les développer au quotidien afin de faire grandir en nous l’esprit du judaïsme.
Nasso : bienveillance et reconnaissance – Rabbin Mikaël Journo
Ce chabbat, nous allons lire la paracha Nasso, l’un des textes le plus long et plus éloquent du Pentateuque sur l’amour d’Hashem pour les enfants d’Israël.
Dans cette paracha, Hashem demande à Moïse de parler à Aharon et à ses fils qui exercent la fonction de cohanim (prêtres) pour lui expliquer comment bénir les enfants d’Israël. C’est ainsi que nous avons ce triptyque : bénédiction et protection, rayonnement de la lumière de D.ieu sur les enfants d’Israël, bienveillance, et le regard dirigé vers les enfants d’Israël, afin qu’Il puisse leur accorder la paix.
Dans les premiers versets, l’expression « Amor La’em », que l’on traduit habituellement par « Vous leur direz » est littéralement traduit par « En leur disant ». Le commentaire de Rachi insiste sur la forme pleine de « Amor », qui en matière d’exégèse, attire l’attention du lecteur averti de la Thora. Celle-ci signifie la plénitude d’un geste, d’une parole, par opposition à une situation qui pourrait présenter des carences voire des failles. Utiliser une forme pleine, c’est pour Rachi une façon de marquer l’idée que les prêtres doivent bénir les enfants d’Israël avec recueillement, concentration et un cœur entier. C’est dire qu’avant même de détailler les mots, il faut que l’élément intentionnel soit constitué.
C’est la raison pour laquelle lorsque les Cohanim nous bénissent aujourd’hui, ils se tournent vers la communauté après avoir prononcé le mot « béahava », qui se traduit par « avec amour ». C’est donc le mot « amour » qui concentre en lui cette bienveillance demandée par Hashem. Précisons aussi qu’à l’époque du Temple, les Cohanim n’avaient pas de revenus : ils n’étaient ni salariés, ni propriétaires fonciers, mais vivaient des offrandes apportées par la collectivité d’Israël. Or, à partir du moment où ces prêtres sont capables de recevoir ces offrandes, ils ne peuvent qu’exprimer gratitude et reconnaissance à l’endroit de leurs bienfaiteurs.
Lorsque Rachi parle de cœur entier, c’est parce que les prêtres travaillent de manière désintéressée, qu’ils œuvrent pour le bien public et qu’ils reçoivent en retour non un salaire mais une offrande. Se sentir redevable de l’offrande apportée par la collectivité, c’est la condition même d’une gratitude et d’un sentiment de redevabilité qui garantit les meilleurs sentiments. En somme pour la tradition juive il y a un art d’offrir mais aussi un art de recevoir.
D’ailleurs, la paracha Nasso est habituellement lue aux alentours de la fête de Shavouot, le temps du don de la Thora. Elle relate aussi les offrandes qui furent apportées par les tribus d’Israël pour l’inauguration du Tabernacle. N’oublions pas que le mot « juif » en hébreu se dit « Yehoudi », du verbe « Léodot », qui signifie « marquer sa reconnaissance ». Être juif au quotidien, c’est aussi savoir exprimer sa gratitude et prononcer dès le lever du matin « Modé Ani Lefaneha », « Je te suis reconnaissant », car le don de la vie est le cadeau le plus précieux.
La Chemita : une mise à l’épreuve de la foi – Rabbin Mikaël Journo
Ce chabbat, nous lirons les parachiot Béhar et Bé’houkotaï et nous terminerons le troisième livre du Lévitique, Vayikra.
Dans la Parachat Béhar Sinaï, il est précisé que la loi de la chemita, la loi du repos chabbatique de la terre, était aussi instaurée sur la Montagne du Sinaï. Le verset nous dit que la septième année, la terre se repose .
Ce commandement consiste notamment à ne plus ensemencer le champ et ne plus tailler la vigne. Nous savons que depuis le livre de l’exode toutes les lois de la Torah ont été révélées au mont Sinaï.
Pourquoi singulariser alors la loi de la chemita en précisant qu’elle avait été aussi donnée au Mont Sinaï ? Pourquoi évoquer cette loi dans ce contexte, alors qu’il en est de même pour toutes les Mitsvots ?
Pour comprendre cette précision, il faut rappeler les implications de la chemita : cette mitsva constitue une véritable mise à l’épreuve de la foi, pour tous les hommes et en particulier pour les agriculteurs, contraints de ne plus travailler pendant un an. Ne pas travailler la terre une année entière alors que hier plus qu’aujourd’hui, le produit agricole constituait la source principale de la nourriture, demandait un véritable sacrifice.
L’inquiétude est si forte qu’elle est verbalisée par le verset biblique. « Et si vous dîtes : que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons pas et n’aurons pas notre récolte ? ». A cela, Hashem donne une garantie particulière : « J’ordonnerai ma bénédiction en votre faveur la sixième année, et la récolte produira pour trois années. « Vous demeurerez en sécurité sur la terre », est-il écrit. En somme, la loi de la chemita est assortie d’une promesse, d’une assurance, que la thora a conscience des préoccupations que pourraient engendrer cette loi.
Le Rav Kook, premier grand rabbin d’Israël, ne s’était pas trompé en visitant tous les kiboutzim, laïcs et religieux, de droite comme de gauche, pour parler des défis spirituels et économiques incarnés par la terre d’Israël. Rappelons que cette mitsva est appliquée aujourd’hui encore en Israël et que cela constitue un défi économique pour le pays et un véritable effort pour tout croyant. La thora exige de nous quelque chose qui dépasse l’entendement. Il nous est demandé en somme, de faire confiance à D.ieu et en sa bénédiction.
Cette garantie de préservation est un véritable défi à la raison humaine. A l’instar du chabbat qui instaure une pause dans les préoccupations professionnelles le samedi, et qui nous engage à nous élever au-dessus de la nature, parce que la Thora d’Israël est au-dessus des lois naturelles.
Nous avons avec cette paracha toute la question de la pratique dont l’exacte signification nous échappe parfois. Hashem souhaite ainsi que nous soyons capables de nous élever au-dessus de la logique terrestre et de lui faire confiance.
Behar – Rabbin Michaël Azoulay
Le rapport très particulier entre la terre d’Israël et ses habitants dont il est essentiellement question dans cette péricope, est évoqué avec beaucoup de justesse par le Professeur Armand Abecassis. Je pense, notamment, à la dépossession du propriétaire terrien une fois tous les sept ans, réalisant ainsi qu’il n’est pas vraiment propriétaire.
Dans la dernière édition de L’Arche, Armand Abecassis développe la question des différents noms qui ont été donnés par la Bible à la terre de Canaan.
L’un d’eux est « Terre de Dieu » (en Osée, 9,3), signifie que « c’est le créateur du monde qui est le suzerain d’Israël » et que si « nous luttons pour que les nations reconnaissent le droit de notre peuple sur cette Terre… c’est parce que nous voulons témoigner devant eux qu’elle n’appartient qu’à Dieu et non aux hommes, et même pas à l’Etat d’Israël ».
Vous imaginez Benjamin Netanyahou tenir un tel discours à l’O.N.U ?
Il ajoute, après avoir explicité un autre nom, à savoir, « Terre de sainteté » (cf. chapitre 18 du Lévitique), c’est-à-dire, une terre qui exige de son résident, une conduite morale, à l’opposé de celle des cananéens : « En fait, la Terre est considérée… comme une personne liée au peuple d’Israël non naturellement mais par une alliance, exactement comme dans la cellule (sic) conjugale. La Terre n’est pas une patrie, encore moins une mère-patrie… il n’y a pas de sentiment patriotique dans la Bible et il ne doit pas y avoir de sentiment patriotique qui nous lie à notre terre ». Vous imaginez tenir ce discours aux israéliens et à Tsahal ? « Nous assistons ici au passage d’un monde où l’homme est enraciné (mère) à un monde où l’homme est un être au dialogue (épouse). Lorsque la Torah prévoit l’exil d’Israël à la suite de la transgression de l’année chabbatique (limitation de sa propriété conditionnelle), elle signifie tout simplement que par faute de pouvoir faire l’expérience de l’exil sur la terre promise qui protège de tout enracinement païen, le peuple d’Israël doit aller faire la même expérience hors de sa terre. »
Be’houkotai –Rabbin Michaël Azoulay
Dans leur ouvrage, Histoire biblique du peuple d’Israël, André et Renée Neher, paix à leurs âmes, après avoir exposé les raisons qui furent à l’origine du choix de Jérusalem par le roi David, comme capitale de son Etat, s’attachent à donner l’étymologie du nom de Yerouchalaïm. Avant de s’appeler ainsi, Jérusalem était « la cité de Jébus », citadelle aux mains des Jébusites, une peuplade cananéenne, avant d’être conquise grâce à l’habileté de Joab, chef militaire de David.
C’est David, second roi d’Israël, qui donnera à cette cité le nom de Jérusalem. Les Neher observent qu’en y installant l’Arche Sainte, David fait de cette ville la métropole religieuse, en plus du centre politique de l’Etat. Pouvoir spirituel et pouvoir temporel se trouvent ainsi concentrés en un même lieu. Les enjeux politiques et religieux actuels autour de cette « ville trois fois sainte », que la plupart des nations refusent de considérer comme la capitale de l’Etat d’Israël moderne, témoignent de son statut complexe.
« Le nom de Yeroushalayim est composé d’une racine yarô que l’on retrouve dans Moria, le nom d’une des collines sur lesquelles s’étend la ville et la racine shalem (dans toute la Bible, le nom que la tradition orale enseigne à lire : Yeroushalayim est orthographié Yeroushalem). Sur le mont Moria Abraham avait préparé le sacrifice d’Isaac. Shalem était la résidence de Malkicédéq. David a associé dans le nom de Jérusalem le souvenir du sacrifice d’Isaac et celui de la piété du roi cananéen Malkicédéq. » (P. 305).
J’ajouterai que Shalom (« paix ») étant dérivé de Shalem, et Ir’a (« crainte ») de yaro et yerou (Guerre et paix, aurait dit Tolstoï), ce nom aura bien présumé du destin mouvementé de cette ville qui passa entre tant de mains, et continue d’être l’objet de bien de convoitises.
Emor –Rabbin Michaël Azoulay
Au-delà d’une volonté de faire le lien entre l’exode d’Egypte et la Révélation au Sinaï, afin de signifier que celle-ci avait pour finalité celle-là, le compte du ‘Omer se justifie-t-il par d’autres raisons ?
Citons ici, parmi de multiples explications, celle, relevant du symbolisme conjugal, du Or ha’Haïm (ouvrage de Rabbi ‘Haïm ben ‘Attar), et de ses implications quant à la vie de couple :
Dieu désirant s’unir à la nation hébreu (lors du don de la Torah), rendue impure par son séjour en Egypte (en raison de l’immoralité et des croyances païennes qui y prévalaient dont Israël subit les influences), lui appliqua la législation de Nidda. Celle-ci requiert de la femme indisposée de compter sept jours de « propreté » (après la fin des menstrues), avant de reprendre la vie conjugale. A ces sept jours correspondent les sept semaines de supputation du ‘Omer, cette multiplication par sept étant motivée, selon notre auteur, par l’extrême état d’impureté du peuple hébreu, ainsi que par l’aspect collectif de cette nécessaire purification, à contrario des lois dites de pureté familiale qui concernent des individus. Ce qui explique également pourquoi le compte du ‘Omer ne débute pas le premier soir de Pessa’h, mais le second (le 16 Nissan), car le premier soir, les hébreux se trouvaient encore en Egypte, dans l’épicentre de l’impureté. Il fallait d’abord s’en éloigner avant de commencer le processus de préparation intellectuel et spirituel au don de la Loi.
Cette dialectique de l’éloignement et du rapprochement se pose dans tous les couples confrontés au défi de l’instauration d’une relation durable. Impossible d’y échapper.
Pour ma part, cette idée de resserrer régulièrement un lien distendu par les aléas de la vie conjugale me semble essentielle. Trop d’« impuretés » polluent la relation entre les partenaires du couple, rendant indispensable le questionnement de chacun de ces partenaires quant aux attentes de l’autre, et, surtout, des résolutions suivies d’actes concrets. En définitive, il s’agirait de compter pour prouver à l’autre qu’il compte.
Aharé Mot Kedochim: Toute vie humaine est sacrée – Rabbin Mikaël Journo
Les événements actuels, nous conduisent à nous interroger sur le sens de la vie dans le monde et en particulier dans le Judaïsme.
La vie représente une valeur fondamentale dans la tradition juive, au point que de nombreux textes affirment que l’on DOIT transgresser les lois de la Torah dans certaines situations.
La source biblique en est le verset du Lévitique (18,5)de notre Paracha « il vivra par elles (les prescriptions) mais il ne mourra pas à cause d’elles ».
Accordant la primauté absolue à la vie, Dieu lui-même renonce, en faveur de l’homme, à ses Commandements.
Ainsi Kippour, le Chabbat, temps sacrés, seront interrompus dans leur pratique pour sauver une vie humaine.
« Aucun interdit de la Torah ne tient devant le sauvetage d’une vie, exception faite de l’idolâtrie, de l’inconduite sexuelle et du meurtre » (Talmud Yoma 82a).
Rashi, dans le Talmud, explique la raison de cette transgression : en ne respectant pas un Chabbat, l’homme restera en vie et il respectera ainsi de nombreux autres Chabbat.
Il semble que Rashi réponde ainsi à celles et ceux qui pensent que la religion n’est qu’un rituel appliqué de manière systématique, sans réflexion personnelle et de manière totalement dogmatique.
Ce faisant, ils ignorent la tradition juive qui sans cesse invite l’homme à interroger le sens de sa pratique.
Le paradoxe de la « transgression » de la Torah alors que celle-ci est un « élixir de vie », peut perturber un homme authentique et droit. Mais il s’agit d’apprendre à vivre dans un monde dont les contours sont souvent difficiles à cerner, où rien n’est blanc, ni noir, mais plutôt noyé de gris et d’ombres parfois visités de fins et brefs rayons de lumière. Dans cet univers, chacun fera l’effort, en étudiant la Torah, de mieux comprendre le message de celle-ci.
On se mobilise donc dès qu’une vie est en danger, car la vie est consubstantielle à la Torah et le judaïsme du coeur, un hymne à la vie.
On n’idolâtre pas pour autant la vie, ce qui deviendrait vite une autre forme de fanatisme, mais on lui donne toutes les garanties du sacré afin qu’elle soit vécue le plus pleinement possible par chacun.
Cette vie que l’on protège fait corps avec l’esprit de solidarité et de fraternité.
Cette vie que l’on soustrait à une fin évitable témoigne du refus de la solitude, de l’exclusion et du rejet de son prochain.
Elle participe à un acte solidaire (Cheviite 39a) qui consiste à ne jamais abandonner l’être humain à sa solitude et sa souffrance.
Nous ne laisserons pas l’homme en exil de lui-même. En sauvant la vie chaque fois que nous le pouvons, nous cherchons à construire comme le prescrit la Torah un monde de paix, de fraternité et de profonde générosité.
Un monde où le bonheur de l’autre, loin de m’handicaper, réjouit mon cœur et représente un acte d’oblation.
A’haré Mot – Rabbin Michaël Azoulay
« Les pratiques du pays d’Egypte, où vous avez demeuré, ne les imitez pas ; les pratiques du pays de Canaan, où je vous ai conduit, ne les imitez pas, et ne vous conformez point à leurs lois. » (Lévitique, 18, 3).
L’auteur du Kéli Yeqar, s’interroge avec nous sur la pertinence des précisions soulignées en italique. Ignorerions-nous (et plus encore les destinataires contemporains de ces exhortations) que le peuple d’Israël a demeuré en Egypte, et que Dieu le conduisit en Canaan ?
Selon notre exégète, ces indications a priori superfétatoires, constitueraient des reproches voilés. Dieu tiendrait rigueur aux hébreux d’avoir demeuré en Egypte, c’est-à-dire, de s’y être installé durablement, puis, d’avoir refusé de s’établir en Canaan (cf. épisode bien connu des explorateurs).
Le séjour en terre des pharaons n’était qu’une étape transitoire avant la conquête de la terre promise. L’extraction du peuple hébreu au moyen des plaies n’aurait été que la conséquence de l’attentisme de ce dernier, elle-même résultant d’un oubli de la place incontournable tenue par la terre promise dans la vocation d’Israël (au point qu’Israël désigne désormais à la fois un peuple et une terre). Le temps fit il son œuvre en transformant la terre d’exil en terre promise ?
Il était alors inévitable que le peuple israélite s’imprègne de valeurs égyptiennes antinomiques avec celles du monothéisme.
Le second motif de reproche réside dans l’attitude des hébreux lors de la tragédie des explorateurs qui entraîna leur lente extinction dans le désert durant quarante ans.
Une sorte de réédition de la première erreur, puisque qu’il s’agit cette fois ci de séjourner durablement dans le désert plutôt que de s’établir dans le pays promis aux patriarches et à leurs descendants, où Dieu les conduit.
Ce commentaire ne peut que nous amener à réfléchir sur deux problématiques qui nous touchent de près, nous, juifs de diaspora. La première concerne le positionnement des valeurs juives vis-à-vis de celles, affirmées ou diffuses, des pays dont nous sommes les citoyens.
La seconde est liée à notre rapport à l’exil et au pays d’Israël. Percevons-nous encore le pays d’Israël comme notre destination finale, ou notre horizon est-il désormais borné par les lieux où nous vivons, travaillons et éduquons nos enfants ?
Kedochim – Rabbin Michaël Azoulay
En réponse à une question qui m’a souvent été soumise :
« Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même : je suis l’Eternel. » (Lévitique, 19, 18).
« Quant aux malveillants qui prétendent que notre législateur ne nous recommande que l’amour du coreligionnaire, nous leur répondrons d’abord que ce législateur est Dieu, et que le créateur du genre humain veut nécessairement l’amour du genre humain.
Nous les renverrons ensuite au verset 34 ci-après et au Deutéronome 10, 18-19, qui ordonnent formellement l’amour de l’étranger ; puis à la Genèse (9, 5) où, dès les temps primitifs, huit cent ans avant la loi du Sinaï, le Dieu de la Bible proclamait tous les hommes frères … Enfin, nous leur citerons cette belle interprétation des rabbins (Abbôth de R. Nathan, fin du chapitre 16) : « Aime ton prochain comme toi-même, car je suis l’Eternel », qui l’ai créé comme je t’ai créé. » Grand Rabbin Lazare Wogue.
Pessah ou le rapprochement des cœurs – Rabbin Mikaël Journo
Durant ces fêtes de Pessah, nous avons à cœur d’appliquer le plus méticuleusement possible les lois relatives à cette période, avec un régime alimentaire d’autant plus contraignant qu’il s’ajoute aux restrictions de la cacherout habituelle.
Nous exauçons à notre époque le vœu de l’Eternel à Moïse, de proscrire le pain levé, d’éliminer toute trace d’aliments fermentés : le Hamets. : « Le levain ne devra pas se trouver dans vos maisons pendant 7 jours « , est-il écrit dans le livre de l’Exode, chapitre 12, verset 19.
Ainsi advient Pessah, dont la semaine représente le cycle des sept jours de la création, un cycle durant lequel nous devons lutter contre le hamets et tout ce qui pourrait nous empêcher d’apercevoir la vérité – cette lumière divine qui parfois est voilée.
Cette lumière nous est en partie restituée lors du Seder, cette soirée pascale interactive qui est une soirée de transmission et d’échange. La nuit pascale permet de restituer et de réhabiliter la relation entre les parents et les enfants, entre les générations, entre les êtres. Nous rêvons que cette soirée soit un temps illimité de lumière, un éclat que nous pourrions partager en famille pour qu’elle éclaire le monde. C’est un retour sur la réceptivité de la parole d’autrui, à l’enseignement, à la libération de nos cœurs.
Pessah nous invite au judaïsme du cœur : à rester réceptif, à écouter, à créer un temps différent.
Rabbi Haïm Luzzatto nous explique que notre dispositivité dépend de nous, de notre disponibilité à réduire l’opacité « de notre fenêtre intérieure ».
Lorsque nous invoquons D.ieu dans la prière, nous lui demandons souvent de nous aider à purifier notre cœur. En somme, nous lui demandons de chasser l’obscurité intérieure, pour permettre précisément le rapprochement des êtres.
Le Hamets que nous devons éliminer et rejeter, représente ce qui nous empêche d’accéder à D.ieu et à un judaïsme du cœur, ce qui permet de faire jaillir la rédemption et la lumière.
L’intention derrière l’action – Rabbin Mikaël Journo
Cette semaine, la paracha Vayikra ouvre le livre de Lévitique : celui-ci porte sur les lois sacrificielles qui seront de rigueur dans le Sanctuaire, un chapitre où il est question d’offrandes, d’abattage rituel et plus largement de la façon dont les règnes animal, végétal et minéral sont mis au service du créateur pour expier les fautes des hommes.
Si l’idée même de sacrifice animal peut être sujette à controverse, y compris chez les rabbins, il n’en reste pas moins que les règles de préparation de l’acte sont très strictes et encadrées, et élèvent l’événement à un niveau symbolique. C’est dans une telle disposition d’esprit que l’on peut arriver à assimiler la substance des commandements divins : en maîtrisant ses passions, pour faire place à la volonté divine en nous. Outre l’offrande en tant que telle, c’est l’élément intentionnel qui compte et qui est la condition essentielle de sa validité : l’homme doit ressentir pleinement ses aspirations spirituelles lorsqu’il accomplit un tel acte, c’est-à-dire se détacher du matériel.
Ce n’est pas par hasard si le nom d’« Adam » est utilisé dès le début du livre de Lévitique, alors que le nom de D.ieu n’apparait que plus tard : comme si l’homme devait recalculer sa place dans le temps et l’espace, se redéfinir dans son rapport à lui-même et au monde avant d’accomplir un sacrifice et de se rapprocher du créateur. Toute cette philosophie est sous-tendue dans cet épisode biblique qui illustre la façon dont Moïse se positionne: il ne se questionne pas sur ce qu’il faut apporter pour amorcer le rituel des offrandes, c’est-à-dire sur les questions matérielles d’intendance
il s’interroge sur sa légitimité. Moïse attend d’être invité par D.ieu pour pouvoir franchir le seuil du Tabernacle et se questionne sur le rituel. Nous sommes au cœur de l’aspiration de l’humanité : l’importance de l’intention derrière l’action.
L’intelligence du coeur – Rabbin Mikaël Journo
Au sujet des Bnei Israël, le rabbin et commentateur Nahmanide note l’utilisation de cette phrase : « Ils sont tous venus, portés par leur cœur ». A cette époque, aucun des hébreux n’était formé aux métiers de tisserand ou d’architecte, aucun ne connaissait les techniques de construction nécessaires à la construction du Tabernacle. Ils n’avaient connu que la misère et la souffrance lors de l’esclavage en Egypte et pourtant, ils se sont révélés être des grands bâtisseurs et même des artistes.
Nahmanide explique que par ces mots, il est question de mettre en valeur l’élan du cœur des enfants d’Israël, qui ont immédiatement répondu à l’appel de Moïse pour collecter les fonds et les matériaux nobles. Ils étaient portés par l’élan collectif de réaliser la maison de D.ieu, cette tente qui abritait l’Arche d’alliance.
Les Bnei Israël étaient mus par un désir commun de construire un lieu dans lequel on inviterait la providence divine et se sont montrés capables de combiner la connaissance aux sentiments, d’unifier la sagesse et le cœur. C’est le rassemblement de toutes les énergies qui a permis de faire naître des ressources insoupçonnées.
Sur cette question précisément, je ne peux m’empêcher de dresser un parallèle avec le monde moderne et de penser à tous ceux qui, il n’y a pas si longtemps, revenaient du pire et qui ont su tout reconstruire : les rescapés et survivants des camps d’extermination. Les nazis leur ont arraché leurs famille, la légèreté de leur adolescence et ils auraient pu en vouloir au monde entier.
Au lieu de cela, ils se sont attelés à reconstruire des foyers et des enfants, sans désir de vengeance : ils se sont révélés être des bâtisseurs et constructeurs.
Après le pire, ils ont fait preuve de cette même intelligence du cœur, cette même force de vie que l’on retrouve dans cette fin du livre de l’exode.
Le livre de l’exode – Rabbin Michaël Azoulay
Parachat Chemot
Cette Paracha, qui donne son nom à l’ensemble du livre de l’Exode, s’ouvre sur le rappel des noms des fils de Jacob.
Le rabbin Moïse Sofer (Screiber), appelé ‘Hatam Sofer (1762-1839), relève la tripartition des noms (Ruben, Siméon, Lévi et Juda, fils de Léa, au verset 2 ; Issachar, Zabulon et Benjamin, au verset 3 ; Dan, Nephtali, Gad et Aser, fils des servantes, Zilpa et Bilha, au verset 4). Le verset central (à savoir le verset 3) citant Issachar, fondateur de la tribu d’Israël vouant sa vie à l’étude de la Torah, Zabulon, tribu des commerçants maritimes, soutenant matériellement Issachar, et Benjamin, dont le territoire en terre promise comprendra le lieu du Temple de Jérusalem, y voit une allusion à la centralité de l’étude de la Torah et du Temple réceptacle de la Présence divine dans le peuple d’Israël.
Le ‘Hatam Sofer ajoute au nom de l’un de ses disciples, dans le prolongement de son premier commentaire, qu’Issachar correspond à la Torah (étude et pratiques juives), Zabulon à la Guémilout ‘hassadim (actes altruistes), et Benjamin à la ‘Avoda (le Service au Temple). Les trois principes sur lesquels « le monde tient », pour reprendre le célèbre apophtegme des Pirké Avot (« Chapitres des Pères ou des Principes »).
Trois manières d’être juif, exprimées par ces trois tribus, pour reprendre une idée d’un disciple du Baal Chem Tov, le Toldot Yaakov Yossef, qui voit dans les douze tribus, douze aspects différents de l’être juif.
Parachat Vaéra
« L’Eternel dit à Moïse : «… je laisserai s’endurcir son cœur, et il ne renverra point le peuple. » (Exode, 4, 21).
« Pour moi, j’endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes preuves de puissance dans le pays d’Egypte. » (Exode, 7, 3).
Cette coercition divine soulève une grande interrogation sur les plans théologique et philosophique car heurtant le libre arbitre et son corolaire, la responsabilité, auxquels la tradition juive est très attachée.
Les théologiens et philosophes du Moyen-Age Saadia Gaon, Juda Hallévi, Albo, Maïmonide, notamment, ont proposé différentes solutions.
Je citerai ici deux d’entre elles.
Selon Maïmonide (1138-1204), lorsque la perversité d’un homme atteint aux yeux de Dieu son paroxysme – en l’occurrence l’obstination du Pharaon à ne pas laisser partir le peuple hébreu – Dieu lui ferme alors la voie du repentir. Le retrait du libre arbitre serait donc une punition divine destinée à châtier le coupable récidiviste.
La seconde explication est proposée par Nehama Leibowitz (1905-1997).
Ce n’est pas Dieu qui prive l’homme de sa liberté mais l’homme lui-même qui s’enchaîne par sa conduite répétitive. Le Talmud exprime cette idée en affirmant que la commission répétée d’une transgression nous désensibilise à son caractère transgressif au point de ne plus y voir un comportement illicite.
Cette explication pêche par une certaine liberté prise avec le texte qui fait de Dieu et non de l’homme l’acteur de l’endurcissement du cœur, mais elle nous met en garde contre les habitudes qui, insidieusement, restreignent notre liberté et endorment notre conscience.
Le phénomène de l’addiction l’illustre parfaitement. Le sujet qui se livre à son addiction a une conscience aigue des abus et de la perte de sa liberté d’action, mais il ne peut plus s’y soustraire. Il n’est donc plus réellement libre et donc condamnable. Toutefois, sa responsabilité est peut être à rechercher du côté du choix premier de la conduite à l’origine de sa dépendance. Lorsque le sujet pouvait encore exercer sa liberté de cesser cette conduite à risque, dont il n’a peut être pas présumé du caractère addictologique.
Parachat Bo
Le rapprochement de deux commentaires du rabbin Elie Munk, de mémoire bénie, portant, respectivement, sur les versets 22 (du chapitre 10 de l’Exode) et 38 (du chapitre 12 de l’Exode), peut nous donner à penser de ce qui fait l’être juif.
Le verset 22 évoque la plaie des ténèbres, l’avant dernière plaie frappant les égyptiens, mais, également, cette fois ci, les hébreux qui ne voulaient pas quitter l’Egypte, selon un midrach cité par Rachi. Tués par Dieu (on ne nous dit pas comment) durant les trois jours d’obscurité, les égyptiens ne les virent pas périr, et ne purent donc prétendre que les hébreux étaient frappés comme eux.
Plus loin (au verset 18 du chapitre 13, début de la Parachat Béchalla’h), Rachi cite un autre midrach estimant à quatre cinquièmes des hébreux le nombre de ceux qui moururent durant cette plaie. Le verset 37 du chapitre 12 avançant le chiffre de 600.000 hommes quittant l’Egypte, 2.400.000 personnes auraient donc succombé durant ces ténèbres.
Au verset 38 susmentionné, il est dit qu’ « un mélange nombreux » s’agrèga aux hébreux. Rachi explique qu’il s’agissait de prosélytes (égyptiens, mais aussi prisonniers de guerre, notamment, selon Philon d’Alexandrie). Le Targoum Yonathan indique le nombre de 2.400.000, soit un nombre équivalent aux hébreux punis par l’Eternel…
Il fut donc une époque, un moment décisif dans l’histoire, où le salut fut réservé aux « juifs d ‘adhésion », tandis que les juifs par atavisme, ne l’assumant plus, ne furent plus considérés par le Très Haut, comme juifs, faute de vouloir l’être. Ce commentaire a finalement le mérite de mettre en exergue une dialectique toujours vivace, entre être juif et devenir juif, une tension où se joue, en permanence, l’avenir du peuple juif.
Parachat Yitro
Pourquoi Dieu a-t-il donné deux tables de la loi à Moïse, contenant chacune cinq des dix commandements, plutôt que de lui remettre une seule table plus longue, qui comporterait les dix commandements ?
La réponse la plus connue consiste à dire que les cinq premiers commandements concernent les relations entre l’homme et Dieu, tandis que les cinq derniers régissent les relations entre l’homme et son prochain.
Plusieurs commentateurs, dont l’auteur du Zohar, proposent une autre réponse : il y aurait un rapport entre chacun des commandements de chaque table, selon l’ordre de leur emplacement.
Ainsi, le 1er commandement serait lié au 6ème, le second au 7ème, le 3ème au 8ème, le 4ème au 9ème, et le 5ème au 10ème.
Démonstration :
« Je suis l’Eternel ton Dieu… » (1) / « Tu ne tueras pas » (6).
Dieu ayant créé l’être humain « à son image » (selon le récit de la création du monde, dans la Genèse), assassiner un être humain c’est ne pas croire en l’existence de Dieu.
« Tu n’auras pas d’autres dieux… » (2)/ « Tu ne commettras pas d’adultère » (7).
Adorer d’autres dieux que le Dieu unique c’est comme être infidèle à son épouse unique.
« Tu ne prononceras pas en vain le nom de l’Eternel ton Dieu… » (3)/ « Tu ne voleras pas » (8).
Le voleur attrapé peut être amené à jurer en invoquant le nom de Dieu qu’il est innocent, prononçant de ce fait le nom de l’Eternel en vain, car il ment.
« Souviens toi du jour du chabbat…car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer…mais il s’est reposé au septième jour » (4)/ « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (9).
Respecter le chabbat c’est témoigner que nous croyons en un Dieu créateur du monde. Donc, transgresser ce jour sacré, c’est comme porter un faux témoignage contre Dieu, en doutant que le monde ait un créateur.
« Honore ton père et ta mère » (5)/ « Tu ne convoiteras pas… » (10).
Nous devons à nos parents de nous avoir mis au monde. Nous devons donc leur dire merci. Ne pas les respecter c’est faire preuve d’ingratitude. Or, c’est justement le fait d’être insatisfait de ce que l’on a, qui est à l’origine de la convoitise, c’est-à-dire, du désir de posséder ce qui appartient à autrui. Dieu donnant à chacun ce qui lui revient, convoiter ce que Dieu ne m’a pas donné, revient à se montrer ingrat.
Parachat Tetsavé
Cette Paracha traite essentiellement des vêtements des prêtres, contribuant ainsi à une réflexion sur le fait de se vêtir caractéristique propre à l’humain. A une époque où les scientifiques font vaciller nos certitudes sur les frontières entre l’homme et l’animal, cette différence persiste. La nudité et son antonyme, l’habillement, sont des sujets récurrents dans la Torah. Petite rétrospective. A l’origine du monde, dans le récit de la Genèse, la nudité de l’être humain – avant qu’il n’ait consommé du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal – traduit son élévation. Le tabou et le fantasme n’existaient pas encore. Et le besoin ressenti de cacher sa nudité reflètera la régression résultant de la transgression.
Il sera à nouveau question de dénudement avec Noé qui s’enivre après le déluge. L’habit sacerdotal est un uniforme. Au sens « couturier », c’est-à-dire un vêtement semblable porté par tous les membres d’un même groupe. Les vêtements expriment toujours une appartenance à un groupe, à une société et à une époque. En monde juif, ceux que l’on appelle les « hommes en noir » ou les hassidim avec leurs codes vestimentaires, en sont une belle illustration. Le Maharal de Prague explique que si l’homme a fait acte de culture avec le vêtement en se différenciant de la nature animale, le juif a encore ajouté un « acte de culte » avec un vêtement à caractère religieux, à savoir celui que l’on porte sur soi (le châle de prière, talith gadol) ou sous ses habits (le talit katan). Vous noterez que la dimension d’appartenance s’y retrouve, puisque le talith et ses franges ont pour finalité de nous remémorer en permanence notre sujétion à l’Eternel, mais, surtout, ils enseignent que pour la tradition juive, l’homme se définit dans et par son rapport à la loi (« vous le verrez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l’Eternel » (Nombres, 15, 39). Ainsi, le talith serait le vêtement des prêtres que nous sommes tous, ayant été qualifiés de mamlekhet cohanim (Exode, 19, 6), « dynastie de pontifes », au pied du mont Sinaï avant la promulgation de la Loi.
Parachat Ki Tissa
La faute du veau d’or dont il est question cette semaine a beaucoup contribué à desservir l’image du peuple d’Israël. De nombreux théologiens y ont trouvé un motif pour vilipender le « peuple à la nuque roide » et prétendre à sa déchéance.
Il est vrai que l’idée même qu’un peuple qui a assisté à tant de miracles et qui, au pied du mont Sinaï, lieu de la promulgation des Dix Paroles parmi lesquelles celles concernant la prohibition de l’idolâtrie, puisse se laisser tenter par elle a de quoi indigner.
Dans un livre considéré comme un « classique » des pensées juives, Le Kuzari, son auteur, l’un des plus grands poètes de l’Age d’or, Juda Hallévi (vers 1075-1141) prête au roi des Khazars des mots très durs à l’endroit du rabbin avec lequel il dialogue sur ces « Israélites qui ont pris un veau pour divinité et l’ont adoré à la place de Dieu. » (Juda Hallévi, Le Kuzari. Apologie de la religion méprisée, traduit et annoté par Charles Touati, Lagrasse, Verdier, 2001, p. 25).
Quelle réponse apporte le rabbin à son interlocuteur ?
Après un long développement historico-métaphysique sur l’élection d’Israël suivi de la question à nouveau posée par le roi Khazar de savoir ce qui « subsiste de cette grandeur après le péché du veau d’or » (p. 28), le rabbin construit la défense de son peuple en minorant la portée de ce péché (argumentation que l’on retrouve chez certains de nos exégètes, en particulier chez Nahmanide) :
Ce péché ne fut commis que par « une partie de cette masse considérable » du peuple. L’interlocuteur du roi Khazar cite le chiffre de trois mille hommes sur six cent mille (3000 correspondant au nombre des idolâtres tués par les lévites à la demande de Moïse. Cf. Exode, XXXII, 28). Il s’agissait donc d’une partie infime du peuple hébreu. De nombreux commentateurs estiment que les idolâtres étaient essentiellement les égyptiens qui s’étaient joints aux hébreux au moment de l’Exode. De surcroit, le veau d’or était « un objet d’adoration vers lequel se tourner comme les autres nations (le rabbin invoque également un argument contextuel, à savoir le fait qu’à cette époque toutes les nations fabriquaient des idoles) sans pour autant renier l’autorité du Dieu qui les avait fait sortir d’Egypte. » Rappelons que le peuple israélite était désemparé voyant que Moïse tardait à revenir du mont Sinaï avec les Tables de la Loi. Le veau d’or était censé remplacer Moïse mais en aucune manière Dieu selon plusieurs exégètes.
Georges Steiner, dans son ouvrage Dans le château de Barbe-Bleue : notes pour une redéfinition de la culture prolongera cette réflexion en soulignant la révolution que constituait une divinité irreprésentable introduite par les hébreux et qui fut selon lui l’une des causes de la haine inextinguible des peuples à l’endroit des juifs. Après l’invention du culte monothéiste écrit-il, les hébreux posèrent une seconde exigence trop élevée pour une humanité incapable de se passer d’images pour adorer ses dieux.
Le veau d’or renvoie en définitive à la tragédie d’un peuple haï pour ses idées trop exigeantes lorsqu’il échoue lui-même à les incarner.
Parachat Pekoudé
Rabbi ‘Haïm ben Attar commentant le verset 32 du chapitre 39 de l’Exode (Parachat Peqoudé) relève qu’il y est dit que «… les enfants d’Israël l’avaient exécuté (la réalisation du tabernacle)… ». Pourtant, il est également indiqué que seul Beçalel secondé par des « gens de talent » (littéralement « sages du cœur ») l’aurait édifié.
Après avoir rappelé le principe du mandat qui, en droit hébraïque, implique que le mandant agit à travers l’action du mandataire (c’est donc l’ensemble du peuple d’Israël qui bâtissait le tabernacle par l’entremise de Beçalel et de ses artisans), l’auteur du Or ha-‘haïm tire de ce verset la preuve que bien que nous soyons dans l’incapacité d’accomplir tous les 613 commandements, nous le faisons par association avec les autres. En effet, le cohen, le lévi, celui qui n’est ni lévi ni cohen, les hommes, les femmes ont certes des commandements en commun mais également certaines prescriptions spécifiques. Comment, dès lors, un individu peut-il prétendre à l’accomplissement de tous les commandements ? C’est la solidarité entre tous les membres du peuple israélite qui, in fine, leur permet d’y parvenir. Celles et ceux, majoritaires, qui ont offert les matériaux nécessaires à la construction du temple du désert ont permis aux artisans et aux tisserands de réaliser le temple, les objets sacrés et les vêtements sacerdotaux. Ils ont donc tous agi de concert. L’Eternel considère qu’il s’agit d’une œuvre collective à laquelle tous et toutes ont pris part.
Belle réflexion sur la mise en commun des forces et des talents à une époque où, dans nos sociétés occidentales individualistes, le sens du collectif se délite.
La foi et la raison, sont-elles compatibles ? – Rabbin Mikael Journo
La Paracha de cette semaine, Michpatim, contient le verset « Naassé Vénishma », qui a fait couler beaucoup d’encre et que l’on traduit par « Nous ferons et nous comprendrons ». Des paroles prononcées par les enfants d’Israël avant de recevoir la Thora, qui posent l’épineuse question du lien entre foi et raison.
Doit-on renoncer à la compréhension des commandements divins pour les respecter ? D.Ieu, nous demande-t-il de faire l’économie du sens pour accéder à la foi ? Où la Thora veut-elle en venir ?
En fait, cet enseignement est profond et fondamental : il nous dit quelque chose de la spécificité de l’âme juive.
Si les enfants d’Israël affirment qu’ils sont disposés à faire avant de comprendre, c’est parce qu’ils ont intégré le fait que l’action entraînait la compréhension et que la émouna, la confiance qu’ils ont en Hachem, nécessitait efforts et humilité.
En somme, les enfants d’Israël acceptent que certains commandements soient dictés par une raison infiniment supérieure à la leur et que tenter de chercher un sens est louable, mais que vouloir tout comprendre instantanément est un péché d’orgueil.
Reconnaître notre finitude face à l’éternité de la loi, c’est reconnaître son origine divine, sans nier le fait que nous avons tous à l’intérieur de nous, une étincelle divine qui brille, puisque nous avons été créés à l’image de Dieu.
Cette foi est héritée de nos ancêtres, elle continuera de nous habiter et de nous guider au nom de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Concrètement, cela signifie que nous acceptons de suivre Hachem non pas aveuglément, mais en commençant par fermer les yeux.
La paracha Yitro – Rabbin Mikael Journo
La Paracha de cette semaine, Yitro, souligne l’importance de la pluralité des pensées. Lorsque les Hébreux sortent d’Egypte et qu’ils errent durant de longs mois dans le désert, ils portent en eux les séquelles du passé, mais aussi les stigmates claniques, tribales, encouragées pendant des siècles par Pharaon.
Les enfants d’Israël sont capables d’être à l’écoute les uns des autres, de tendre l’oreille aux autres expressions même celles qu’ils peuvent juger blessantes, et c’est ainsi qu’ils arrivent ensemble devant le mont Sinaï pour recevoir le Décalogue.
Les commentaires insistent sur le fait de ne pas tenter de gommer ces différences, de ne pas tenter d’inventer une unité de façade, mais au contraire, de fixer le cadre de l’opinion et de la pensée différentes dans le respect des uns et des autres. Le peuple d’Israël est capable de promouvoir l’art de la différence qui permet de trouver progressivement un consensus pour se rassembler.
Il n’existe pas de baguette magique qui permet de créer un monde unifié et ce n’est pas souhaitable. C’est cela, aussi, la beauté du Judaïsme : le rassemblement passe par la prise en compte des différences.
Cette année Simhat Torah : « Réjouissez-vous avec (retenue) tremblements » – Rabbin Mikael Journo
La célébration de Simhat Torah s’inscrit dans un moment de clôture, celui de la lecture annuelle de la Torah. Cette fête célèbre aussi le recommencement d’un nouveau cycle. Entre la fin et le début il n’y a pas de rupture mais une continuité : une fidélité.
Ce recommencement n’est pas qu’une répétition c’est aussi l’occasion d’un renouvellement, d’enrichir et d’approfondir notre lien avec la Torah. L’occasion de mieux comprendre et d’agir mieux en conformité avec nos valeurs. Cette célébration de la Torah s’inscrit dans la joie.
Mais en cette période incertaine où la pandémie règne sur notre quotidien, où les rapports sociaux et humains sont bouleversés, où pour nous protéger il faut s’éloigner physiquement les uns des autres et prendre des mesures pour ne pas se contaminer.
Dans ce temps étrange où la présence dans nos synagogues est contingentée et dépend du nombre d’inscrits pour éviter la contamination, il nous faut continuer à espérer et vivre autrement cette célébration de la Torah.
Nos Maitres du Talmud (Berahote30 B) nous avaient déjà préparé : »Réjouissez-vous avec tremblements ». (Psa.2,11).
Nous prenons tous conscience un jour, que la vie réserve de la tristesse et de la souffrance. Tant que l’on n’y est pas confronté, cela peut bien sûr inquiéter, angoisser mais cela reste un sentiment abstrait. Lorsque l’événement dramatique survient, rien ne nous a préparé à l’affronter. C’est le moment où se révèle notre capacité à accepter la vie avec ses épreuves mais aussi à trouver dans l’existence des raisons de vivre dans l’harmonie avec D.ieu, le monde et soi-même.
Celui qui reste enfermé dans la pénombre de la tristesse et du pessimisme ne peut que souffrir, il se ferme les portes de ce qui pourrait l’apaiser et lui apporter une espérance. Comment la crainte de D.ieu peut-elle être associée à la joie, ne sont-ils pas des sentiments contradictoires ?
L’hébreu biblique propose plus de dix synonymes pour exprimer la joie, car celle-ci est un élément pivot de la vie juive. La joie est la condition essentielle de l’observance du Chabbat, selon la lettre même de la Torah (Isaïe 58,13). La fête de Soukot nous invite à la joie : » Tu te réjouiras pendant la fête » (Deut.16).
Pour la prière, le psalmiste (100,2) ne s’exprime-t-il pas ainsi : » Servir Dieu dans la joie et se présenter à lui avec des chants d’allégresse » ?
Le Talmud, plus explicite affirme que la présence divine ne réside pas où règne la tristesse, mais auprès de ceux qui » accomplissent les Mitsvot dans la joie » (Chabbat 3b).
C’est la » Simha chél Mitsva » : la joie que procure l’accomplissement de la Mitsva. Le Baal Shem Tov disait que » le seul fait de vivre dans la joie constitue l’accomplissement de la volonté divine ».
Même si l’on fait référence à Job dont l’histoire traduit la souffrance indicible, ne peut-on dire que malgré la succession de malheurs qui l’accablent, il y a chez lui une volonté farouche d’accepter son sort en plaçant sa confiance en D.ieu ?
Cette démarche évoque un thème de la psychologie moderne avec la pensée de Boris Cyrulnik sur la résilience. Sur la capacité de l’individu à surmonter des traumatismes et à se reconstruire.
Le peuple juif a vécu de nombreuses tragédies. Mais malgré la haine, l’adversité et l’horreur, il ne s’est jamais laissé aller au désespoir. Sa survie passait par la farouche détermination à surmonter les obstacles les plus terrifiants pour vivre et transmettre à nouveau un message d’espérance. Notre lien avec Dieu doit se traduire par la plénitude de la joie au long de l’existence. Une joie qui peut se traduire de manières différentes.
Dans l’étude de la Torah mais aussi dans la contemplation de la nature, l’écoute d’une musique qui illumine notre intériorité, dans le regard d’un enfant et dans une multitude de faits qui, même s’ils sont éphémères, remplissent notre cœur d’émerveillement et de gratitude. Le sentiment de joie touche l’être dans toutes ses dimensions. La joie, cependant, n’a de sens que si elle permet d’être en symbiose avec soi-même et avec les autres. Elle est aussi un acte de générosité.
Vivre sans joie empêche un être de s’épanouir comme l’affirmait le Baal Chem Tov, « sans la joie, la crainte de Dieu n’est que mélancolie ». Alors malgré les vicissitudes de cette période mouvante où un virus capricieux et dangereux nous empêche de vivre normalement comme on le souhaiterait il faut garder en nous la force de croire en D.ieu et d’espérer en l’Homme.
L’eau et le saule : L’humilité, source de joie et de fraternité – Rabbin Moshé Sebbag
J’aimerais parler de la fête de Souccot, dont la traduction en hébreu est « cabanes ». Le texte du Lévitique exprime ainsi ce commandement : « L’Éternel parla à Moïse… Parle ainsi aux enfants d’Israël : Le quinzième jour de septième mois aura lieu la fête de Souccot… Vous demeurez dans les souccot durant sept jours afin que vos générations sachent que j’ai fait demeurer les enfants d’Israël dans des cabanes quand je les ai fait sortir du pays d’Egypte ».
La fête de Souccot est également définie par la Torah comme une célébration joyeuse, « le temps de notre réjouissance » (Dt. XV, 14-15). Autrefois, la joie de Souccot était rehaussée par la fête du puisage de l’eau, Simhat Beit ha Choéva. La liesse et les réjouissances accompagnaient la cérémonie des libations d’eau qui étaient versées sur l’autel pendant les prières pour la pluie. C’est en effet à Souccot que l’on récite la prière pour la pluie, car d’après le Talmud, « le monde est jugé, pour l’eau » (RH 1,2). Pendant la fête de Souccot la Torah nous ordonne de prendre quatre espèces de plantes que l’on agite à différents moments de la liturgie. L’Etrog (le cédrat), le Loulav (la branche de palmier), les Hadassim (les trois branches de myrte), et les Aravot (les deux branches de saule). Ces quatre espèces, disposées en bouquet, symbolisent le peuple juif.
Le cédrat est savoureux et parfumé, de même dans le peuple juif des Hommes connaissent la Torah et sont vertueux. La branche de palmier porte des dattes, fruit délicieux mais sans parfum, de même dans le peuple juif des Hommes connaissent la Torah mais ne sont pas vertueux. Le myrte est parfumé mais n’a pas de goût, de même dans le peuple juif des Hommes sont vertueux mais ignorants de la Torah. Quant au saule qui ne possède ni parfum ni saveur, il symbolise ceux dans le peuple juif qui ne réalisent pas de bonnes actions et ne connaissent pas la Torah.
Face à cette diversité du peuple juif, que fait D. ? « Ils se réuniront tous en un seul bouquet et ils expieront les uns pour les autres. Et si vous faites ainsi, j’en serai élevé…, à partir de quand il en sera élevé ? Quand ils seront tous réunis » (Amos.9,6).
Le septième jour, le summum de la fête de Souccot, est Hochaana Rabba, (d’après la Kabbale le verdict de yom Kippour est alors scellé). Ce septième jour, nous prenons seulement les Aravot, les deux branches de saule, qui n’ont ni saveur ni parfum, mais qui ont la particularité de pousser précisément au bord de l’eau. Il est écrit dans le Traité Soucca 45a qu’au Temple de Jérusalem, de grandes branches de saule étaient coupées pour être placées autour de l’autel. Les Cohanim sonnaient le Chofar et chaque jour les fidèles faisaient le tour de l’autel une fois. Le jour de Hochaana Rabba, sept tours étaient effectués. Ce passage vient nous enseigner que nous avons le devoir d’accorder une plus grande importance aux « Aravot » qu’à toutes les autres espèces de plantes réunis pour Souccot.
Pourquoi le saule est-il mis en valeur à Souccot ?
Avant de répondre, j’aimerais préciser que l’eau, la pluie et les végétaux sont au centre de Souccot. Quel est leur lien avec les réjouissances ordonnées par la Torah pendant Souccot ?
L’eau est au cœur des traditions des réjouissances de Souccot. Or l’eau a une particularité : elle est mobile, elle s’écoule : arrivée dans la plaine ou dans la vallée, elle trouve des fissures pour continuer son chemin vers le cœur de la terre. L’eau prend toujours la forme de l’espace qu’elle rencontre.
L’eau est le symbole de l’humilité et de la sagesse dans le judaïsme. La fête de Souccot tourne autour de l’eau et donc autour de l’humilité comme condition de la joie : l’homme humble est heureux de ce qu’il a et de ce qu’il obtient grâce à son dur labeur. Il ne convoite pas ce qu’il n’a pas encore, il ne désire pas ce qui ne lui appartient pas.
A Hochaana Rabba, septième jour de Souccot, des quatre espèces, nous gardons exclusivement les Aravot (le saule sans parfum ni saveur). Cela doit nous rappeler que nous devons nous présenter devant l’Éternel, sans penser que nous possédons d’avantage qu’un autre, que nous sommes mieux qu’un autre, plus croyant qu’un autre, ou que l’on se conduit mieux qu’un autre.
C’est l’humilité qui est le point commun entre l’eau et le saule. Cette humilité est la source de joie lorsque nous nous satisfaisons de ce que nous avons. Cette humilité est également propice à la fraternité entre les Hommes, sans hiérarchie ni jugement de valeur.
Je me questionne, donc je suis – Rabbin Mikael Journo
En cette période, je vous propose une réflexion sur la notion du questionnement critique mais constructif. Souvent on s’imagine que celui qui croît ne doute pas. C’est évidemment un cliché qui cherche à rassurer mais qui dissimule une réalité bien plus ambiguë. Pour le judaïsme, l’esprit critique est recherché et enrichissant. La passion pour l’interrogation est devenue au fil des siècles un ingrédient essentiel de la culture juive.
Ainsi le mot sagesse se dit en hébreu « Hokhma » qui peut se lire aussi Koah – Ma, la force du Pourquoi ? Les lettres hébraïques ayant des valeurs numériques, celle du mot « Adam » qui signifie homme est égal au mot « Ma » qui veut dire, quoi ? Pourquoi ? Ne peut-on pas en déduire que l’homme est une question ? Le judaïsme n’est pas un dogme qui enferme et fige la pensée. Il faut fuir la pratique d’un rituel vide de sens où l’on ne pense plus et où l’on n’agit que par routine. D.ieu n’a pas offert à l’homme un rouleau de la Torah sibyllin. La Torah est, au contraire, une parole vivante, ouverte et féconde.
L’étonnement de l’homme est la condition préalable et nécessaire à son accès à la connaissance et au savoir. C’est une possibilité offerte à l’homme de se confronter au texte de la Torah, de l’étudier et de l’interroger. Nos sages nous enseignent que l’homme est invité à apporter sa touche personnelle, sa pierre à l’édifice, son Hidouch, au cheminement de la pensée juive. Grâce à cela, la Torah ne demeure pas une lettre morte, un testament, elle est Torat–Haim, une Torah de vie, une tradition source de vitalité.
L’originalité de l’étude talmudique consiste à refuser une lecture monolithique et enseigne qu’un texte est indéfini car infini et ouvert à toutes les nouvelles interprétations. La notion de Mahlokèt, questions, discussions, débats est constitutif du Talmud à tel point que la terminologie talmudique propose plus d’une quarantaine de synonymes pour dire le mot question. C’est dans la confrontation d’idées et d’opinions que jaillit la lumière de la vérité. Et le rôle du maître n’est pas tant d’apporter des réponses mais d’apprendre à l’élève à savoir poser des questions. Ainsi la recherche de la vérité ne s’épuise jamais et l’homme reste élève de la sagesse, un Talmid-hakham.
C’est-à-dire que la sagesse demeure toujours un but à atteindre même pour les plus grands sages qui ont l’humilité de toujours vouloir apprendre. Le questionnement juif admet les contradictions et la complexité, sources de renouveau et d’enrichissement mais ces dernières s’inscrivent sans aucun lien avec l’idée de rupture, source de séparation et finalement d’échec. Cette démarche s’inscrit dans un esprit de continuité qui relie toutes les idées les unes aux autres en vue de s’approcher de la parole de D.ieu et d’agir pour le bien.
La Téchouva – Rabbin Haïm Torjman
Roch Hachana, notre nouvel An, se fait sans réveillon et sans cotillon, sans cépage et sans champagne : c’est un moment réservé à la prière et à la méditation.
Cependant, sommes-nous conscients de l’importance de ce jour ?
Savons-nous quel est l’enjeu de cette solennité ? Aujourd’hui, D.ieu va juger toutes les créatures de l’univers. Mais le Créateur avait-il besoin de fixer un jour particulier pour ce jugement ?
Nos sages disent : ‘’ Un œil regarde, une oreille écoute et toutes les actions sont inscrites dans un livre’’. Rien, non, rien n’échappe au Très Haut. De plus, ce jugement, serait-il celui qui se tient dans l’hémicycle d’un Palais de Justice ?
A-t-Il besoin d’écouter les plaignants, les intéressés de la partie civile, les témoins retenus pour l’audience afin de prononcer son verdict ?
En réalité, ce jour est un appel à l’introspection, à l’examen de conscience de tout un chacun afin de nous remettre en question !
Dans notre calendrier, les fêtes brillent comme des pierres précieuses, chaque pierre avec sa couleur, chaque fête avec son éclat spécifique ! Le point commun de chaque évènement est d’élever l’homme au-dessus du courant tumultueux de la vie.
La diversité des fêtes vient renforcer l’homme afin qu’il ne s’oublie pas dans la grisaille du temps, la course effrénée de son existence. Tout au long de l’année, nous avons été envahis par un certain nombre de tourments, de difficultés, d’inclinations. Nous avons commis un certain nombre d’erreurs, de fautes. Nous n’avons pas eu le temps, ou la volonté d’analyser, de faire le bilan de ces égarements.
En effet, tout pécheur est en délit de fuite. De qui fuit-il ? De lui-même ? Quiconque faute, le remord l’envahit, sa conscience est heurtée. Alors, que fait-il ? Il court dans le domaine public, vers un lieu où le tumulte, l’effervescence de la vie font taire le léger murmure de son âme blessée ! Le pécheur a peur de se retrouver avec lui-même et de réfléchir à sa situation.
Il court après de nouvelles impressions et sensations quotidiennes afin de ne pas rester un seul instant avec sa conscience intérieure. Plus l’homme s’éloigne de lui-même, plus il éprouve une certaine répulsion pour sa personne et plus il est aliéné (étranger à lui-même) : une faute en entraîne une autre…
Plus ses erreurs se multiplient et plus la peur de se retrouver face à lui-même ira grandissante. Il ne lui reste qu’une seule possibilité, tout au moins lui semble-t-il : c’est d’être emporté par le flot de la vie et de ses délectations !
Comme cet ivrogne qui appréhende de constater l’amère réalité dans laquelle il se trouve et a besoin de morphine pour connaître un peu de bonheur dans sa fiction. Ne sait-il pas que ce bonheur est mensonger !? Malgré tout, il préfère ses fantasmes à la réalité profonde dans laquelle il se trouve sans aucune goutte de réconfort, de consolation.
Le fauteur, prisonnier dans le piège que lui a tendu le Yetser Hara, préfère boire le verre des délices de ce monde ci jusqu’à la lie afin de s’enivrer, de s’oublier et de s’affranchir ainsi de ce dialogue, peu agréable à ses yeux, avec la partie divine de son âme que l’Eternel a insufflé en lui.
La Téchouva, la Pénitence, c’est avant tout s’arrêter et retrouver le point où l’on a commencé à fuir ! Revenir du domaine public, des futilités de ce monde vers le domaine privé de son âme.
Nous pourrons, alors, nous retrouver et ceci nous permettra de nous dégager de notre ivresse et de notre cécité. De-là, le concept de la Téchouva, du Repentir. Il ne s’agit pas seulement, de regretter ou de prendre des engagements ou encore des résolutions, il faut aussi et surtout faire Téchouva, faire un retour.
Il est dit : ‘’Tu reviendras jusqu’à l’Eternel ton D.ieu’’, c’est-à-dire qu’il faut revenir vers D.ieu qui est en toi, avoir une oreille attentive à la voix de ta conscience, alors tu trouveras les potentialités de la partie divine qui est en toi : ne pas écouter les voix extérieures mais la voix intérieure.
Pour arrêter un juif qui fuit, qui court de toutes ses forces, la Torah a placé des signalisations : Stop, Danger, Ne pas dépasser…
Chauffeur, la vie des hommes est entre tes mains !
Il existe 4 temps privilégiés :
Comme l’enseigne le Prophète AMOS (réf 3,8) :
Le lion a rugi qui n’aurait pas peur ? אריה שאג מי לא יירא
LION = א ר י ה
/ / \ \
אלול ראש השנה יום כפור הושענה רבה
Hochaana Raba Yom Kippour Roch Hachana Elloul
Ces 4 temps sont des signalisations pour informer et interpeller un juif afin d’arrêter sa course effrénée et sache quel virage de la vie il doit emprunter !
En guise de conclusion, nous souhaitons partager avec vous cette petite anecdote :
Un homme vient voir son maître et lui demande :
– Rabbi, je désire me repentir mais je ne sais pas comment m’y prendre !
– Pour pêcher, tu savais comment faire
– C’est facile, je fautais d’abord, je savais ensuite…
– Parfait, fais la même chose maintenant. Commence par te repentir, tu sauras ensuite… En effet la Téchouva ouvre toutes les portes.
Que l’Eternel nous ouvre les portes de la Téchouva, de la Paix, de la Subsistance, de la Santé, de la Joie et du Bonheur et que cette année soit le tremplin d’une vie au voisinage de l’Eternel. Amen.